 referencement sur bing - référencement de site web gratuit -
referencement sur bing - référencement de site web gratuit -

La question de la transmission scolaire a toujours fait débat. Le vieil affrontement entre tenants de l’instruction et ceux de l’éducation resurgit aujourd’hui, à travers de virulentes critiques de la notion de compétences.
Il n’est guère de question plus centrale pour l’école que de définir ce que l’on juge bon et nécessaire d’y transmettre aux élèves. Depuis plusieurs décennies, les débats autour de ce que l’école doit transmettre sont marqués par une opposition polémique : faut-il transmettre aux élèves des compétences – savoir prélever une information dans un texte, par exemple, ou des savoirs – ou leur faire connaître une récitation par cœur ? Cette opposition recouvre sans nul doute des positions idéologiques, mais elle soulève aussi de vraies questions pédagogiques et philosophiques.
L’école et le monde du travail
La carrière de la notion de compétence débute en France à l’orée des années 1980, après que nombre de critiques ont ébranlé l’école (1). Elle devait accepter de ne plus avoir le monopole de la transmission des connaissances et admettre que les savoirs scolaires ne sont ni sacrés ni indiscutables. En outre, Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron sont passés par là (avec La Reproduction publié en 1970) et la critique de l’élitisme de la culture scolaire constitue une figure obligée, d’autant qu’avec la démocratisation des études, le lycée n’accueille plus seulement des « héritiers ». Les débats se nichent aussi dans un contexte de relatif dégel des relations entre l’école et le monde du travail et d’efforts pour revaloriser les formations professionnelles, avec le développement de la formation continue et des collaborations avec les milieux de l’entreprise qui importent dans le milieu scolaire des questionnements jusqu’alors incongrus : et si l’alternance pouvait être « éducative », de quoi a-t-on besoin pour s’insérer dans la « vraie vie » ?
Ces questionnements, certains pédagogues progressistes les avaient avancés depuis longtemps. Les pédagogues de l’éducation nouvelle (Ovide Decroly, Célestin Freinet, John Dewey…) prônaient une pédagogie active, rendant l’élève autonome dans la construction de ses savoirs, en d’autres termes compétent bien plus que savant. À partir des années 1970, de nombreux pédagogues donnent la priorité aux méthodologies d’apprentissage (« apprendre à apprendre ») par rapport aux savoirs disciplinaires, dans la mouvance du sociologue britannique Basil Bernstein. Celui-ci défendait une pédagogie « visible », découpant et explicitant les apprentissages, ainsi plus faciles à maîtriser par les élèves culturellement les plus éloignés de l’école, à l’opposé de cette pédagogie « invisible » opaque et élitiste, emblématique des lycées français d’alors. On entendait par là substituer à la hiérarchie des savoirs une représentation plus horizontale de la diversité des compétences, donnant ainsi une chance à chacun.
La science contre le marché ?
En France, sous l’étendard de pédagogues comme Philippe Meirieu, de nouveaux concepts pédagogiques apparaissent comme l’interdisciplinarité, la pédagogie par objectifs, ou par contrat, le travail de groupe, l’individualisation… La priorité est de former des personnes autonomes, à même de se débrouiller dans la vie, grâce à une gamme ouverte de « savoir-faire » et de « savoir-être ». Même si des intellectuels comme Alain Finkielkraut se déchaînent alors, au nom de la République, contre ces pédagogues qui attaquent les savoirs et sacrifient l’instruction à l’éducation (2), les textes officiels entérinent cette évolution. En France, la charte des programmes de 1992 consacre la notion de compétences exigibles en fin de formation, et le programme devient ainsi un « contrat d’enseignement », avec un élève que la loi d’orientation de 1989 place « au centre du système ».
D’emblée, la notion de compétence a suscité des réticences. Les enseignants sentaient bien qu’elle véhiculait subrepticement une conception différente des savoirs et du rôle de l’école, en promouvant un apprentissage en acte, un bricolage jugé à son efficacité en quelque sorte et que tout élève autonome pouvait réussir. Formés à la maîtrise d’une discipline, valorisée pour elle-même et fondement de leur autorité, ils ne pouvaient ignorer que cela augurait d’une transformation de leur travail avec les élèves, et revenait à contester la vertu intrinsèquement éducative, démocratique, libératrice, des savoirs disciplinaires, tels que définis et délivrés par eux seuls.
Depuis les années 2000, la critique de l’approche par compétences prend une nouvelle tournure : ne consacre-t-elle pas une entrée en force du néolibéralisme à l’école (3) ? Dans un monde du travail où les qualifications requises sont imprévisibles et variées, le travailleur, pour être efficace, doit se mobiliser, se montrer flexible et polyvalent. Et c’est bien pour répondre à ces besoins de l’économie et soutenir la croissance économique, suprême arbitre, que l’OCDE s’est investie dans les questions de formation, encourageant les États à rationaliser leurs systèmes éducatifs pour doter les jeunes des compétences dont ils auront besoin dans leur vie, en premier lieu professionnelle. Avec les enquêtes Pisa lancées en 2000 sous son égide, on entend évaluer les compétences des élèves de 15 ans dans trois domaines : compréhension de l’écrit, mathématiques, culture scientifique. Au-delà des programmes nationaux, l’essentiel est d’appréhender ce que les jeunes sont capables de faire à 15 ans ; par exemple, sont-ils capables de comprendre, d’utiliser et d’analyser des textes écrits ?
Une fois les compétences entrées à l’école, s’est mise en place toute une machinerie évaluative qui a de quoi rendre perplexes les enseignants : comment chiffrer le degré de maîtrise de compétences atomisées et parfois fort abstraites telles qu’« adapter sa communication en fonction du contexte » ? Et puis, comment être sûr que ces compétences que l’on s’échine à évaluer et qui seraient la sanction suprême de l’efficacité de l’enseignement sont bien transférables : la performance d’un élève – il parvient à comprendre tel texte écrit – garantit-elle, au-delà de l’exercice réussi, une compétence générale, quels que soient les textes et toute sa vie durant ?
De fait, si l’on dégage ces réticences de leur gangue corporatiste ou idéologique, l’approche par compétences soulève de vraies questions, essentielles pour les pédagogues (4). Celle du transfert tout d’abord : comment faire en sorte que les apprentissages réalisés en classe permettent à l’élève d’apprendre ensuite, quand il le faudra ? Mais aussi et plus largement, comment faire en sorte que ces savoirs soient véritablement formateurs, c’est-à-dire aident l’enfant à s’épanouir et à s’insérer dans la vie ?
Vastes questions, mais que l’on ne peut éluder en préconisant un retour à la primauté des savoirs : il n’est pas possible pour penser ce que l’élève devient, grâce à ses apprentissages, capable de faire, d’opposer savoirs et compétences. Pour réussir à utiliser une machine quelle qu’elle soit, on ne saurait soutenir qu’il suffit de connaître sur le papier son fonctionnement (ou de lire les instructions), ou bien, selon l’approche par compétences, de la manipuler… Le savoir joue un rôle dans l’action, pour déboucher sur la maîtrise.
Une dictature de l’utile ?
Une autre vraie question concerne cette primauté de l’utile que distillerait l’approche par compétences. La rhétorique du « à quoi ça sert » est d’autant plus mobilisée que l’on juge les élèves a priori peu intéressés par la chose scolaire. De plus, le contexte de l’emploi rend prioritaire le caractère « rentable » de ce que l’on apprend. Il n’y a là rien de méprisable : réussir sa vie ne se réduit pas à passer dans la classe supérieure grâce aux savoirs scolaires accumulés, chacun a besoin de trouver un débouché dans le monde du travail tel qu’il est. Il n’en demeure pas moins qu’il est fort hasardeux de délimiter l’utile d’aujourd’hui par rapport aux incertitudes de demain. De plus, tenter de motiver les élèves par l’utile les rend… utilitaristes et tue le sens de tous les apprentissages à l’utilité incertaine, sans compter les déceptions que la vie leur réservera à cet égard.
En filigrane, il y a la question de savoir quelle éducation l’on promeut si l’on accepte cette dictature de l’utile. La philosophe Martha Nussbaum (5) dénonce une éducation « tournée vers le profit ». Elle promeut au contraire une éducation à la démocratie, développant l’indépendance d’esprit, l’imagination et la capacité d’empathie, et fondée pour ce faire sur les humanités et les arts. Il ne s’agit pas de promouvoir une discipline de plus, mais un état d’esprit, en invitant les élèves à se mettre dans la peau d’un personnage de roman, à analyser leurs émotions devant une œuvre d’art, à s’étonner de si bien comprendre les propos d’un auteur – philosophe ou politique – datant de plusieurs siècles… Éduquer, ce serait aussi permettre aux élèves d’éprouver le plaisir des découvertes gratuites, le plaisir de surmonter la difficulté d’un raisonnement, le plaisir de comprendre, de « retrouver le sens des savoirs et de la culture »… (6)
Si les débats savoirs versus compétences sont si vifs, c’est parce qu’ils interrogent la nature, l’ambition et les modalités d’une éducation qui ne se réduit pas à la transmission de savoirs. La notion de compétence a le mérite d’expliciter les objectifs que l’on vise et par conséquent d’ouvrir le débat sur ce que doit être le projet éducatif de notre école : si l’on peut contester le caractère démocratique des directives européennes en matière de compétences à transmettre, est-on si sûr que la façon dont le monde académique liste les savoirs disciplinaires à mettre au programme l’est beaucoup plus ? Une véritable réflexion sur la culture à dispenser à tous exige de dépasser l’opposition savoirs/compétences (7), mais aussi de se poser d’autres questions, peut-être (encore) plus dérangeantes, celle du bien-fondé du monopole de l’école et des spécialistes d’une discipline sur l’éducation, de la valeur formatrice d’une éducation par le « tout intellectuel ».
(1) Voir Françoise Ropé et Lucie Tanguy (dir.), Savoirs et compétences. De l’usage de ces notions dans l’école et l’entreprise, L’Harmattan, 2003.
(2) Voir Martine Fournier, « École : l’instruction contre l’éducation », Sciences Humaines, n° 178, janvier 2007.
Disponible sur www.scienceshumaines.com/
(3) Voir Christian Laval et al., La Nouvelle École capitaliste, La Découverte, 2011, ou Angélique Del Rey, À l’école des compétences. De l’éducation à la fabrique de l’élève performant, La Découverte, 2010.
(4) Voir Marcel Crahay, « Dangers, incertitudes et incomplétude de la logique de la connaissance en éducation », Revue française de pédagogie, n° 154, janvier-février-mars 2006.
(5) Pour une présentation de ses thèses, voir www.laviedesidees.fr/L-utilite-sociale-des-humanites.html.
(6) M.Gauchet « Contre l’idéologie de la compétence, l’école doit apprendre à penser » (Le Monde, 02/09/2011). Voir aussi Marie-Claire Blais, Marcel Gauchet et Dominique Ottavi, Pour une philosophie politique de l’éducation, Bayard, 2002.
(7)Voir les réflexions de Philippe Perrenoud : « Le socle et la statue », Cahiers pédagogiques, 2006, n°439, 16-18.
http://www.scienceshumaines.com/connaissances-ou-competences-que-transmettre_fr_28987.html
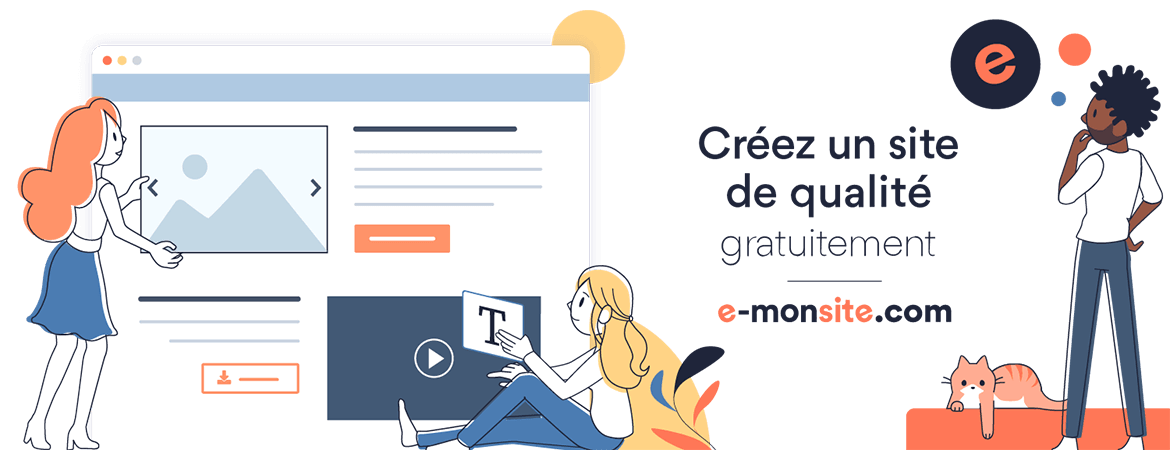
1. Par Mehdi El le 2025-04-10
Bon travail Merci
2. Par wassim le 2024-02-26
tres bien
3. Par fistone le 2023-07-09
Bon courage
4. Par mouna el achgar le 2023-07-09
je suis une enseignante de la langue française et cette année je vais enseigner pour la première fois ...
5. Par Salwa le 2023-03-18
Merci
6. Par Rbandez le 2022-11-19
Trés Bon resumé
7. Par Rbandez le 2022-11-19
Trés Bon resumé
8. Par El otmani le 2022-11-01
Bonjour Merci pour votre exemple je le trouve vraiment intéressant Auriez-vous un exemple pour une ...