 referencement sur bing - référencement de site web gratuit -
referencement sur bing - référencement de site web gratuit -

Fumer accélère le vieillissement du cerveau et affecte ses capacités. L’effet concerne en particulier l’épaisseur du cortex, notre matière grise.
Le cortex cérébral se divise en couches de neurones et en aires (régions) qui assurent des fonctions cognitives, sensorielles et motrices. Son épaisseur maximale est atteinte pendant l’enfance, se maintient, puis s’amincit. Comme l’expliquent ces chercheurs de l’université McGill (Montréal), « des études antérieures ont montré qu’avec l’âge avançant, les fumeurs présentent un risque accru de déclin cognitif plus marqué », et ceci concerne notamment la mémoire, la résolution de problèmes, le langage, l’attention… Cette situation pourrait bien être liée à un amincissement accéléré du cortex.
C’est en tout cas ce que suggère l’observation par résonance magnétique (IRM) de cerveaux de fumeurs, d’anciens fumeurs et de personnes qui n’ont jamais fumé. La moyenne d’âge était de 73 ans. Après avoir tenu compte d’une série de paramètres qui auraient pu influencer le résultat, il s’avère que le cortex cérébral des fumeurs est davantage aminci dans plusieurs zones, et ceci dans des proportions suffisamment significatives pour qu’on puisse en tirer des conclusions pertinentes.
Un cortex plus mince par rapport aux non-fumeurs, alors que chez les ex-fumeurs, un amincissement est constaté mais avec une nuance importante : l’arrêt du tabac stoppe le processus de dégradation. Autrement dit, pour le bien de son cerveau (sans parler de toutes les autres bonnes raisons…), il ne faut jamais fumer, et si on a commencé, mieux vaut arrêter le plus tôt possible.
http://www.passionsante.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=17996

Un zéro pointé isolé n’a rien d’une catastrophe nationale. Si en revanche les mauvaises notes s’accumulent sur son bulletin, inutile d’attendre pour chercher à comprendre ce qui se passe dans la tête de votre enfant.
Qu’il s’agisse d’un simple contrôle raté ou de mauvaises notes à la chaîne, une punition assortie d’une réprimande est loin d’être la bonne solution. Dans les deux cas, votre enfant se trouve en situation d’échec. En rajouter ne peut qu’aggraver son humiliation et lui enlever toute confiance en lui.
Simple dérapage ? Regonflez-lui le moral.
Nul n’est parfait, et même si vous avez la nette impression que votre fils ou votre fille n’a pas fait le maximum pour décrocher la moyenne, n’en faites pas un drame. Il aurait l’impression que vous remettez en question votre affection pour lui sur un simple résultat. A un âge où l’on doute de tout, surtout de soi, c’est très déstabilisant. Et il risque la prochaine fois, de tout faire (falsifier la note, signer à votre place ou ne pas oser rentrer à la maison) pour éviter votre réaction.
Ce que vous pouvez faire : tirez ensemble la leçon de cet échec ponctuel.
Etait-ce un manque de travail, un problème de compréhension ou plutôt de concentration ? L’essentiel est de ne pas répéter les mêmes erreurs.
Bulletin médiocre : menez l’enquête.
Accumuler les 3/20 dans la plupart des matières, ça ne s’appelle plus un accident de parcours. N’en déduisez pas pour autant que vous avez un cancre à la maison ! Cette accumulation de mauvaises notes peut signaler un malaise du côté de votre ado. Un enfant anxieux et émotif peut perdre ses moyens face à sa feuille de contrôle. Il peut aussi être fatigué, ne pas arriver à se concentrer, être mal à l’aise face à un professeur ou tout simplement avoir l’impression que ses résultats ne vous intéressent pas. Et en perdre du coup toute motivation !
Ce que vous pouvez faire : seule l’association de plusieurs facteurs permet de mettre un terme à la spirale d’échec.- Intéressez-vous à son travail scolaire: lui demander comment s’est passée la journée et s’il a besoin d’un coup de main pour ses devoirs, le rassurera sur votre intérêt. - Mettez de l’ordre dans son rythme de vie : surveillez son alimentation, son sommeil, prévoyez un lieu calme pour étudier… - Enseignez-lui une méthode de travail: les enfants à la traîne ne savent pas s’organiser. Ils ne savent pas étudier une leçon, analyser un texte. C’est le travail du professeur, mais ce dernier n’a jamais le temps de vérifier si ses consignes de début d’année ont été bien assimilées par tous. -Allez voir ses professeurs : ils ont une vision de votre enfant, souvent très différente de la vôtre. L’association de vos deux points de vue permet souvent de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de votre rejeton. - Motivez-le : n’hésitez pas à montrer votre joie à la moindre amélioration. En revanche ne lui promettez surtout pas d’argent en échange d’une bonne note! Un résultat scolaire ne se monnaye pas. - Vous fâcher : seulement quand vous êtes sûr qu’il prend son travail scolaire par-dessus la jambe. Pas question de hurler, mais recadrer votre ado en lui rappelant fermement que ce n’est pas en perdant son temps à redoubler qu’il va concrétiser son projet d’avenir. Et en prenant si besoin, des sanctions. Pas de sorties tant qu’il n’a pas rattrapé ses 10 leçons de retard. Ce n’est pas un abus d’autorité de votre part, mais le juste retour de bâton auquel il doit s’attendre s’il ne prend pas ses responsabilités.
3 questions au psy- Que faire face à un enfant qui ne semble pas se soucier de ses résultats ? D’abord, ne pas juger trop vite. Certains enfants, surtout les garçons, jouent souvent les « bravaches » pour cacher leur contrariété derrière une petit air désinvolte. Aucun enfant n’aime avoir de mauvais résultats, sauf s’il le fait exprès pour attirer l’attention de ses parents. - Dans quels cas ? Quand il a l’impression que ses parents ne s’intéressent pas assez à lui et à son travail. Dans ce cas, demander à voir ses cahiers ou à contrôler ses devoirs du soir, loin d’être ressenti comme une intrusion par le jeune adolescent, permet au contraire de le rassurer sur l’intérêt (et donc sur l’amour ! ) de ses parents, et de le remotiver sur le plan scolaire. Les périodes de conflits familiaux, séparation, problèmes avec un aîné ou un cadet, peuvent aussi entraîner des chutes de résultats. - Il est donc plus normal qu’un enfant affiche sa contrariété ? Jusqu’à un certain point. Pleurer pour un zéro est une réaction de déception normale. Mais il n’est pas sain non plus d’en faire un drame. Au collège et au lycée, certains enfants de nature anxieuse ont tendance à se sentir nuls à la moindre mauvaise note. Pour éviter cette dévalorisation systématique, tout l’art des parents est d’être suffisamment exigeants sans avoir des ambitions excessives qui risquent de mettre une pression insupportable sur les épaules de leurs enfants.
http://www.magicmaman.com/,comment-reagir-a-ses-mauvaises-notes,46,143.asp

3 raisons pour lesquelles il est si difficile d'enseigner
1. Parce que nous prenons toute chose pour évidente dès lors que nous l'avons compriseApprendre quelque chose à quelqu'un consistant d'abord à accepter le fait qu'il ne sache ni ne comprenne quelque chose qui pourtant nous paraît évident depuis belle lurette, il va falloir faire l'effort de se souvenir de cette époque où, comme l'élève, nous non plus, ne savions pas. Effort d'autant moins intuitif pour l'ego qu'il nous remémore un passé d'ignorant que nous avons bien vite oublié.
2. Parce que se mettre à la place de l'autre est contre-intuitif.Apprendre quelque chose à quelqu'un se différenciant de "faire la leçon" par l'intérêt que porte l'enseignant à la façon d'apprendre de son élève, enseigner réclame donc de l'empathie. Soit cette capacité à se mettre à la place de l'autre tout en restant à la sienne, dont la vie quotidienne démontre chaque jour à quel point elle peut faire défaut à nos semblables
3. Parce qu'à chaque élève, sa façon d'expliquer (en théorie)
Apprendre quelque chose à quelqu'un reposant sur l'aptitude du recevant à intégrer un message, transmettre réclame non seulement de répéter mais surtout de répéter différemment pour trouver le "canal d'entrée" le plus réceptif chez la personne en face de lui. Pour rappel: les visuels vont retenir les images et éprouver des difficultés à analyser/mémoriser les sons, les auditifs feront le contraire, les conceptuels ne feront ni l'un ni l'autre et apprendront les idées, quant aux kinesthésiques, ils ont envie de manipuler tout ce que vous leur dites avec les mains.
8 techniques pour apprendre quelque chose à quelqu'un
1. Votre passion est votre ennemie
2. Faites-le reformuler
3. Anticipez les difficultés
4. Lors de la première explication, élaguez au maximum
5. Une chose a un nom (et le garde)Votre expérience dans le domaine considéré vous amène souvent à jongler sans y penser avec le champ lexical, intervertissant les mots tout en sachant toujours ce que vous désignez. Pensez que, pour votre interlocuteur, tout est nouveau, même les mots! Je suivais récemment une formation à Photoshop et mon coach pour l'occasion utilisait alternativement les expressions "zones de travail" et "fond" comme équivalant parfaits, au petit détail près qu'il avait oublié de me le dire! Quoique vous expliquiez à un débutant, une chose a un nom et un seul. Pas deux.
6. Si une explication ne "rentre" pas, changez d'explication!Peut-être le point le plus important. Si la définition des concepts ne doit plus changer (voir point précédent), la clef consiste en revanche à varier la façon d'expliquer. Le dicton populaire disant que la pédagogie passait nécessairement par la répétition est incomplet: utilisée seule, la "bête" répétition n'a jamais été une pédagogie en soi! Mon professeur de boxe me faisait remarquer que mes crochets n'étaient pas à la hauteur de mes directs (au sens propre et figuré) et j'avais du mal à les corriger. Cela faisait des dizaines de fois qu'il me répétait de ramener l'avant-bras parallèle au sol mais cela ne passait pas, j'étais (ou plutôt, mon canal) "bouché". Je lui ai alors demandé, en sueur mais sur le ton de la plaisanterie, de me l'expliquer d'une autre manière. Avec d'autres mots, une autre image. Nouvelle version: "fais comme si tu donnais un coup de coude". Résultat j'ai compris. Je rate, encore, parfois, mais j'ai bien compris.
7. Utilisez des analogies, ou le pouvoir du "fais comme si"Souvenez-vous que la personne qui vous fait face, aussi novice qu'elle soit sur le sujet du jour, est experte dans d'autres dont vous ne savez probablement rien. Ou pas grand chose. Mettez à profit ce "capital" en utilisant des images: "fais comme si". A un enfant qui apprend le piano, pour "passer le pouce": "fais comme si tu voulais le cacher sous la paume de ta main". A un élève de chant, pour apprendre la "respiration basse": fais comme si tu gonflais un ballon sous ton nombril, etc.
8. Apprendre vs admirer, chaque chose en son tempsVous n'en avez pas conscience, mais à ses yeux vous êtes un virtuose dans votre domaine, et les quelques manipulations de base auxquelles vous pourriez vous livrer inconsciemment devant lui l'impressionnent déjà grandement. Ne faites pas étal de votre "virtuosité" (même relative) pendant l'explication, ça déconcentre l'apprenant. On ne peut pas admirer et apprendre simultanément. Chaque chose en son temps. Si vous apprenez l'informatique à quelqu'un, efforcez-vous par exemple de ne pas utiliser les multiples raccourcis claviers que vous connaissez, vous le perdriez immédiatement.
Vous connaissez maintenant les bases de la pédagogie. Alors appelez votre ado, confisquez son iPhone pendant 15 minutes, et apprenez-lui quelque chose qui vous plaît! Transmettre est un plaisir sans équivalent.
http://www.huffingtonpost.fr/staphane-edouard/8-techniques-pour-enseigner-avec-pedagogie_b_5392323.html

A quoi ressemblera l'homme dans 1000 ans?
Depuis que l'homme est homme, son corps et son visage n'ont cessé d'évoluer. Et ce n'est pas fini! Des experts spécialisés en anatomie humaine ont tenté de déterminer à quoi les générations futures ressembleront dans 1000 ans.
Le tabloïd britanniqueThe Sun s'est alors amusé à réunir leurs prédictions, pour finalement dévoiler une estimation de l'Homme d'après demain. Résultat: finis les Brad Pitt, Johnny Depp et autres George Clooney. Envolées Monica Bellucci, et Shakira. Nos descendants seront bien loin des canons de la beauté actuels.
Dans le détail, selon le journal, les humains seront de plus en plus grands au fil du temps grâce aux progrès de la médecine et à une meilleure alimentation. "Aujourd'hui, l'Américain moyen mesure déjà 2,5 centimètres de plus qu'en 1960", constate l'ostéopathe Garry Trainer. En 3012, nous atteindrons jusqu'à 2,10 m. Dans 1000 ans, Michael Jordan et Teddy Rinner seront donc des petits joueurs.
Plus grands, et moins gros: certains de nos organes liés à la digestion, en particulier les intestins, seront plus courts afin d'échapper naturellement à l'obésité.
Un plus petit cerveau
L'utilisation toujours plus intensive de technologies telles que les iPhones ou les claviers, engendrera une transformation de nos mains, qui seront plus sensibles grâce à un afflux de terminaisons nerveuses, ainsi que de nos bras, qui seront plus longs pour nous permettre de moins bouger. Fainéants de surcroît!
A cause de l'influence de ces gadgets électroniques, l'homme sera beaucoup plus ridé qu'aujourd'hui. Ridé mais moins velu. En effet, la climatisation et le chauffage central réduiront notre pilosité. Une sorte de cadeau de consolation.
Côté cerveau, pourquoi s'encombrer? Une partie du travail de pensée et de mémorisation pourra être déléguée à nos ordinateurs, ce qui justifiera une réduction de la taille du cerveau.
Les édentés
A force de manger des nourritures plus molles, l'humain aura moins de dents et une plus petite bouche. "On peut penser que notre alimentation se présentera sous forme de liquides ou de pilules, ce qui aboutira à l'avenir à une mâchoire moins importante" affirme le dentiste Philip Stemmer. Il est même prévu que l'homme de l'an 3000 arbore des quadruples mentons à cause de la sédentarité. Charmant.
En revanche, ses yeux seront plus grands. Pour y voir la nuit, tel un hibou? Que nenni, "La communication sera davantage basée sur les expressions faciales et le contact visuel", explique Cary Cooper, de l'université de Lancaster en Grande-Bretagne.
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/a-quoi-ressemblera-l-homme-en-3012_1173258.html
Le visage humain dans 100 000 ans : Regardez ce à quoi nous pourrions ressembler par Gentside
Les relations sont souvent conflictuelles au moment de l’adolescence. Rares sont les familles qui échappent à ce constat. Parfois le climat s’est tellement dégradé qu’on assiste à un réel blocage. Chacun restant sur ses positions. La communication devient de plus en plus difficile. L’incompréhension est presque totale.
|
Il reste toutefois une piste intéressante à explorer : la rédaction d’un contrat entre parents et enfants. Le contrat est un outil puissant qui présente bien des avantages s’il est suffisamment réfléchi et discuté avant sa rédaction par les deux parties. ;;;;• La concertation et la négociation Avant de se lancer dans la rédaction d’un contrat, il faut s’entendre sur les points qui seront mentionnés et les engagements que chacun est prêt réellement à consentir. En rétablissant la confiance, chacun pourra s’engager un peu plus. Petit à petit, on observera de réels progrès. ;;;;;• La rédaction du contrat Quelques règles s’imposent en matière de rédaction de contrat dès lors qu’il s’agit de définir les engagements des uns et des autres : 1. La description du point abordé doit être précise et concrète Ainsi on retiendra que pour être efficace un contrat devra être concret, limité dans le temps, positif, réaliste et court. ;;;;;• Le processus Bien souvent la situation de départ entre parents et enfants est confuse, tendue et conflictuelle.
· Passer de l’incompréhension totale à un début de compréhension ;;;;;• L’heure du bilan Etablir un contrat c’est impérativement en définir clairement la durée d’application et savoir très précisément quand aura lieu l’heure du bilan. Attention également à garder en mémoire ce principe : Plus la durée est raisonnablement courte, plus son efficacité sera grande. Ne pas oublier que les enfants ont tendance à se décourager rapidement
Dossier : Béatrice VICHERAT http://apprendreaapprendre.com/reussite_scolaire/article.php?cat_num_sel=&numtxt=673
|
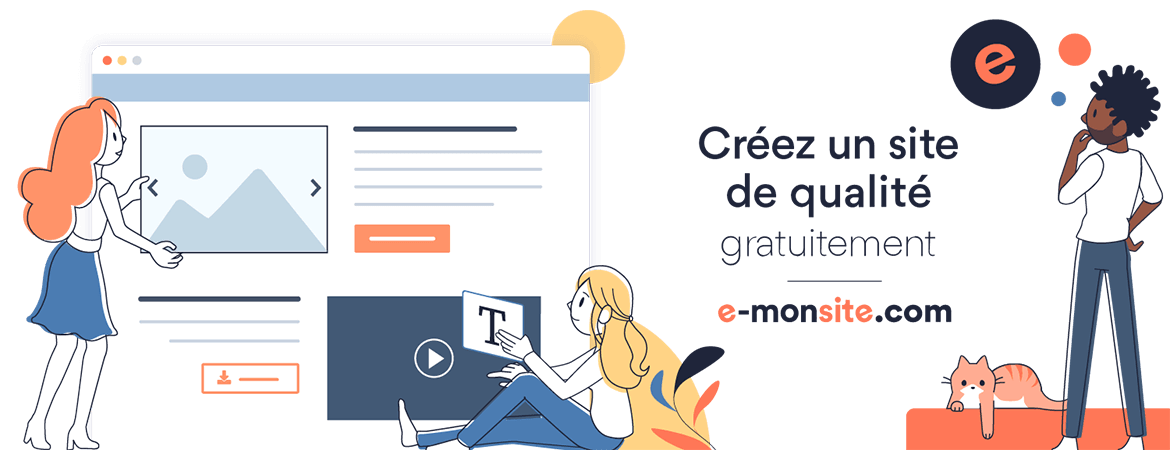





1. Par Mehdi El le 2025-04-10
Bon travail Merci
2. Par wassim le 2024-02-26
tres bien
3. Par fistone le 2023-07-09
Bon courage
4. Par mouna el achgar le 2023-07-09
je suis une enseignante de la langue française et cette année je vais enseigner pour la première fois ...
5. Par Salwa le 2023-03-18
Merci
6. Par Rbandez le 2022-11-19
Trés Bon resumé
7. Par Rbandez le 2022-11-19
Trés Bon resumé
8. Par El otmani le 2022-11-01
Bonjour Merci pour votre exemple je le trouve vraiment intéressant Auriez-vous un exemple pour une ...