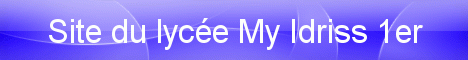 referencement sur bing - référencement de site web gratuit -
referencement sur bing - référencement de site web gratuit -

"Quand j’étais petit, je croyais naïvement que pour réussir sa vie, il fallait bien travailler à l’école.
Après tout, la réussite scolaire mène aux meilleurs diplômes. Les meilleurs diplômes mènent aux meilleurs emplois. Les meilleurs emplois mènent aux meilleurs salaires. Et l’argent fait le bonheur ![]()
Puis j’ai cessé de croire au Père Noël, le choc !"

La plupart des bacheliers décidés sur l’établissement où ils vont poursuivre leurs études ou alors ils vont décider dans les prochains jours.
Une peur de l’inconnu accompagne en général cette période et des questions sont posées ici et là :
Est ce que c’est difficile ? Comment je dois réviser ? Comment marche le système ? …
Aujourd’hui nous n’allons pas répondre à ces questions, parce que les études supérieures est un monde si différent des études secondaires que même plusieurs articles ne seront pas suffisants pour donner une image fiable de ce monde.
Mais il faut se mettre dans la tête une idée essentielle :
L’objectif principal des études supérieures c’est de permettre à l’étudiant de travailler une fois diplômé.
Donc on peut conclure que l’objectif n’est pas d’avoir les meilleures notes ou le meilleur classement (sauf pour les filières style classes prépa qui ne rentrent pas dans cette catégorie). Le but principal est donc de se préparer à intégrer le monde du travail après, 2 ans, 3 ans, 5 ans voire plus !
Au lieu de vous servir un long discours, je préfère citer des conseils donnée par Anas El Filali, médecin de formation et entrepreneur.
Les conseils de Dr El Filali sont très pertinents, et je vous recommande personnellement de les suivre ! Certes la chose la plus facile dans les études universitaires c’est d’étudier seulement, mais en sortant des sentiers battus, vous gagnez plus !
http://www.9rayti.com/conseils-pour-reussir-ses-etudes-superieures

« Trouvez en une minute le maximum de prénoms qui commencent par M ! » « Cherchez le maximum d’utilisations possibles d’un trombone ! » Voilà le genre de questions formant la trame des questionnaires de créativité. Les techniques de création littéraire, du type OuLiPo, reposent sur le même principe : il s’agit de construire une petite histoire à partir de quelques mots (éléphant, New York, camembert, inflation, jalousie…).
Il est à noter que dans ces exercices, la créativité est toujours stimulée par une règle. La contrainte ne limite pas la création, elle l’aiguillonne. Sur ce principe, Georges Perec a écrit un roman de plus de 300 pages – La Disparition (1969) – sans utiliser une seule fois la lettre « e », la plus courante de la langue française.
Les premiers tests de créativité ont été inventés dans les années 1950. À l’époque, le QI régnait en maître dans l’étude des aptitudes intellectuelles. Le psychologue américain Joy P. Guilford, alors l’une des figures dominantes de la psychométrie, a eu l’idée de construire un test pour mesurer les capacités créatives. En comparant avec les performances au QI, il a découvert que les performances de créativité ne recouvraient pas celles de l’intelligence : preuve que l’on pouvait être très créatif sans être forcément très intelligent (et inversement, être intelligent sans être créatif).
J.P. Guilford a alors essayé de comprendre sur quelles aptitudes reposait cette créativité. Et il en est venu à conclure à l’existence d’une « pensée divergente ». Alors que le QI est la capacité de trouver « la » bonne réponse à un problème, la créativité serait la capacité à imaginer une palette variée de solutions : d’où le terme de « pensée divergente » (notons que l’idée de « pensée divergente » était largement commandée par la nature des tests eux-mêmes, tout comme les tests de QI proposent implicitement une définition de l’intelligence de type verbal et logico-mathématique).
L’approche expérimentale initiée par J.P. Guilford et par Ellis Paul Torrance (auteur du Torrance tests of creative thinking, TTCT) va par la suite imprégner toutes les recherches en laboratoire sur la créativité. C’est ainsi que vont se développer des études fructueuses sur les styles cognitifs ou sur l’évolution de la créativité en fonction de l’âge (1).
Une autre piste d’étude de la créativité porte sur la psychologie du « génie ». Comment pensent les Léonard de Vinci, Mozart, Picasso, Einstein, etc. et tous ceux qui ont révolutionné leur domaine, dans les arts, les sciences, les techniques ? Le concept qui a guidé la masse de travaux consacrés aux « génies » a longtemps reposé sur deux idées implicites. D’abord que la créativité relève d’une personnalité d’exception ; ensuite que les génies sont des originaux, en rupture avec l’esprit de leur époque. Albert Einstein est ce savant échevelé, qui s’est formé en marge de l’institution scientifique, et qui tire la langue aux autorités. Mozart aussi était un insupportable garnement, anticonformiste, facétieux. Et comme les déviants, marginaux ou même fous ne manquent pas parmi les artistes (Vincent Van Gogh en est le symbole), il était aisé de conclure que génie et folie rimaient bien ensemble (2).
Une autre idée souvent avancée relève de « l’effet eurêka ». Nombre d’inventeurs, de mathématiciens, de créateurs ont décrit certaines de leurs découvertes sous la forme d’une intuition soudaine – le fameux « eurêka » d’Archimède. Les psychologues ont décrit ce phénomène sous le nom d’« insight », une brusque réorganisation d’éléments disparates qui apparaît sous la forme d’une illumination (3).
Le psychologue américain Milahy Csikszentmihaly soutient, quant à lui, que ces moments privilégiés de découverte surviennent dans un état de conscience particulier, le « flow », qui correspond à un moment d’attention flottante où l’esprit vagabonde.
Mais à force de fouiller dans les secrets intimes du génie, de scruter leur vie privée et leur histoire, les spécialistes en sont peu à peu arrivés à des conclusions moins héroïques et singulières qu’on l’avait imaginé.
L’un des premiers à avoir remis en cause le modèle du « génie créateur » est Robert Weisberg, auteur de Creativity, Genius and Others Myths (1986). Selon lui, la biographie des grands créateurs révèle souvent des gens obstinés (ayant quelques idées fixes et non une pensée divergente) et très gros travailleurs, contrairement à l’image du dilettante qui découvre le secret de la gravitation en voyant tomber une pomme d’un arbre. Les scientifiques ou les artistes d’exception sont en général des experts qui sont à la pointe de la science ou de l’art de leur époque : ce ne sont nullement d’aimables amateurs qui furètent à l’écart des sentiers battus. Ce fut le cas pour Einstein comme pour Picasso. Les découvertes simultanées démontrent au passage que l’innovation plane dans l’air du temps, et que les spécialistes d’un domaine chassent sur les mêmes terres, au même moment et avec des stratégies semblables.
Enfin, il est très difficile de trouver un trait commun aux formes de créativité qui s’expriment dans les arts, les sciences, les techniques… Après avoir exploré la biographie de grands hommes (Einstein, Igor Stravinsky), Howard Gardner, théoricien des « intelligences multiples », en conclut qu’il existe aussi des créativités multiples (4).
Le psychologue Dean Keith Simonton, lui, a passé en revue la biographie de centaines de poètes, d’inventeurs, de mathématiciens réputés créatifs dans leur domaine. Au terme de ses recherches « d’historiométrie », il est parvenu à ce résultat : il y a certes un âge moyen de plus grande créativité, se situant à l’âge de jeune adulte (avec un pic entre 35 et 40 ans), mais ce n’est pas vrai pour toutes les disciplines : en musique, en philosophie, on peut être créatif jusqu’à un âge avancé. D.K. Simonton insiste également sur le fait que bien d’autres facteurs, autres que la personnalité ou l’âge, influent sur la créativité. Il est très difficile d’être créatif dans une période qui ne l’est pas. Inversement, il est des périodes et des contextes qui poussent à l’innovation. À la dynamique individuelle d’invention doit s’ajouter un milieu favorable où puissent s’épanouir certaines innovations.
Les psychologues sont donc parvenus à la conclusion qu’il n’existe pas une mais plusieurs formes de créativité (5), que les personnes les plus créatives sont celles qui combinent motivation, persévérance, originalité plutôt qu’un seul trait, que le poids stimulant du milieu est essentiel et, enfin, que le génie est moins extraordinaire qu’on le croit (6). Ce qui veut dire aussi qu’il y a un peu de génie en chacun de nous.
NOTES
(1) Voir Todd Lubart, Psychologie de la créativité, Armand Colin, 2003, et Todd Lubart et Chantal Pacteau, « Le développement de la créativité », Sciences Humaines, n° 164, octobre 2005.
(2) Sebastian Dieguez, Maux d’artistes. Ce que cachent les œuvres, Belin, 2010.
(3) Ronald A. Finke, Thomas B. Ward et Steven M. Smith, Creative Cognition: Theory, research, and applications, MIT Press, 1992.
(4) Howard Gardner, Les Formes de la créativité, Odile Jacob, 2001.
(5) Voir Jacques Cottraux, À chacun sa créativité. Einstein, Mozart, Picasso… et nous, Odile Jacob, 2010.
(6) Mark A. Runco, Creativity: Theories and themes: Research, development, and practice, Elsevier, Academic Press, 2007.
Et si la créativité n’était pas un signe d’originalité mais, au contraire, un acte mental très banal ? Telle est l’idée défendue aujourd’hui par des chercheurs psychologues, philosophes, spécialistes de sciences cognitives qui s’intéressent à l’esprit imaginant (1).
Au-delà de leurs différences, tous partagent une approche nouvelle de l’imagination qui repose sur quelques idées clés.
L’imagination est une caractéristique fondamentale de la cognition humaine. Elle est entendue dans un sens très large de capacité à produire des images mentales et à les associer pour former des « mondes possibles » : anticipations, fictions, mais aussi hypothèses ordinaires (ou « abductions »).
Cette imagination prend la forme d’images mentales, de nature essentiellement perceptive (visuelle, sonore, émotionnelle), organisées en schémas simplifiés (ou prototypes) et contraignants : quand on imagine des extraterrestres, ils prennent la forme de petits bonshommes verts, ou avec trois yeux et cinq bras : l’imagination ne fait qu’assembler sous une forme nouvelle des éléments connus. Au fond, l’imagination est pauvre.
La capacité créative repose, selon Max Turner, sur l’analogie qui consiste à trouver des ressemblances cachées entre des éléments apparemment disparates. La pensée analogique serait l’un des piliers de la créativité (en art et en science).
NOTE
(1) Ilona Roth, Imaginative Minds, Oxford University Press, 2007.

Des chercheurs japonais ont réussi à décoder le contenu partiel de rêves. Une expérience qui pourra être utile pour comprendre des maladies psychologiques ou commander des machines par la pensée.
Une équipe de chercheurs japonais a annoncé avoir réussi à lire une partie d'un rêve d'un humain, une expérience qu'ils pensent utile pour analyser l'état psychique d'individus, comprendre des maladies psychologiques ou encore commander des machines par la pensée.
"Depuis longtemps, les hommes s'intéressent au rêve et à son sens, mais jusqu'à présent, seul le rêveur en connaît le contenu", rappelle Yukiyasu Kamitani, un des chercheurs d'un laboratoire de l'Institut international de recherche en télécommunications avancées de Kyoto. Pour aller plus loin dans la compréhension scientifique des rêves, ces scientifiques ont imaginé un dispositif de décodage des images vues par un individu durant la phase onirique.
Enregistrer l'activité cérébrale
Pour cette expérience, les scientifiques ont à maintes reprises enregistré l'activité cérébrale de trois personnes durant leur phase de sommeil. Ils les ont réveillées volontairement quand apparaissait sur l'écran d'analyse un signal correspondant à une phase de rêve pour leur demander quelles images ils venaient de voir. Puis ils les ont laissé se rendormir pour recommencer l'opération, environ 200 fois par sujet.
Cela a permis de constituer un tableau de correspondances entre l'activité cérébrale précise à ce moment et des objets ou sujets de diverses catégories - nourriture, livre, personnalités, meubles, véhicules, etc. - aperçus dans les rêves. Il s'agit d'une sorte de lexique qui associe un signal en provenance du cerveau à une image.
Des prédictions avérée dans 60 à 70% des cas
Une fois cette base de données constituée et enrichie d'autres informations, la lecture de l'activité cérébrale par imagerie à résonance magnétique (IRM) pendant la phase de sommeil et de rêve a permis au système de "deviner" ce que voyait en rêve le sujet, grâce à l'apparition des mêmes signaux caractéristiques.
Dans 60 à 70% des cas, la prédiction s'est avérée exacte. "Nos résultats démontrent que l'expérience visuelle spécifique au cours du sommeil est représentée par des schémas d'activité cérébrale, ce qui fournit un moyen de découvrir le contenu de rêve en utilisant une mesure neurologique", a expliqué l'équipe du professeur Kamitani.
Une application directe
Le développement de cette technologie pourrait avoir de nombreuses applications. Et l'une d'entre elles constitue une réelle avancée scientifique.
En effet, cela permettrait de comprendre et de voir ce qu'il se passe dans le cerveau des personnes plongées dans le coma ou atteintes de maladies neurodégénératives, donnant la possibilité d'établir un nouveau dialogue avec ces patients.
Pour Jack Gallant, le co-auteur de l'étude, cette avancée "est un grand pas vers la reconstruction de l'image interne (...). Nous sommes en train d'ouvrir une fenêtre sur les films dans notre esprit".
http://www.rts.ch/info/sciences-tech/4796128-des-chercheurs-ont-reussi-a-decoder-le-contenu-partiel-de-reves.html

|

La formation du cerveau est une extraordinaire histoire, avec son explosion neuronale, ses ramifications, ses spécialisations, ses morts cellulaires. Un déploiement qui exige à la fois la mobilisation des gènes, de l’environnement et de l’expérience pour s’épanouir pleinement.
La naissance de l’univers et l’émergence de la vie sont les deux quêtes les plus fondamentales de la création. Mais une troisième question d’égale d’importance consiste à se demander comment le cerveau humain et l’esprit ont été formés. Cette question est essentielle tant pour la compréhension de l’être humain que pour apporter une réponse aux deux premières questions : car c’est le cerveau qui pense et cherche à comprendre. On parle souvent du Big Bang des origines de l’univers, mais pas si souvent du Big Bang que représente la fabrication du cerveau : 100 milliards de neurones se forment et se connectent. Il y a à peu près autant de neurones dans le cerveau que d’étoiles dans la Voie lactée.
Seize jours après la fécondation, le cerveau est déjà né. Au départ, c’est une forme floue faites de cellules indifférenciées. Quatorze jours après la conception, trois couches de cellules sont déjà formées. La couche supérieure, l’épiblaste, va devenir le système nerveux et la peau. La couche inférieure, l’hypoblaste, correspondra aux organes internes, comme les intestins. Entre les deux, le mésoderme apparaît, une couche à partir de laquelle se forment les os et les muscles. L’embryon s’organise aussi selon un axe "tête-queue", le long d’une ligne primitive : la notochorde. C’est une structure cellulaire flexible, en forme de tige. La notochorde fonctionne comme un chef d’orchestre, transmettant des ordres aux cellules. C’est autour de cet axe, avec une tête et une queue, que l’organisme se structure. Ce processus, la gastrulation, peut être considéré comme l’événement le plus important de la vie. S’il n’avait pas lieu, notre organisme serait comme celui d’un ver.
Comment les cellules souches indifférenciées, aussi appelées cellules embryonnaires, se développent-elles pour se spécialiser et devenir par exemple les cellules nerveuses ? Le professeur Hans Spemann et Hilde Mangold, son étudiante de deuxième cycle, ont découvert la réponse en 1922, à Freibourg, en Allemagne. H. Spemann avait découvert le phénomène de l’induction, c’est-à-dire le fait que la différenciation cellulaire chez l’embryon dépend d’un stimulus venu des tissus voisins. Il suggéra à Hilde de tenter une transplantation d’un fragment cellulaire d’un embryon de salamandre à un autre. Après des centaines de tentatives, avec l’aide d’un scalpel à microscope, elle réussit à obtenir une salamandre à deux têtes pourvues de cerveaux complets. La seconde tête était principalement constituée de cellules du receveur et non du donneur, ce qui indiquait que la fabrication du système nerveux est liée à un facteur chimique.
Lorsque H. Mangold a soutenu sa thèse en 1923, le philosophe Edmund Husserl était dans le jury. On peut se demander s’ils ont parlé du cerveau et de l’esprit, puisque E. Husserl était un phénoménologue de la conscience. Mais un an plus tard, H. Mangold mourut tragiquement. En parfaite femme allemande, elle vouait sa vie à ses enfants et à la cuisine. Alors qu’elle était en train de réchauffer le biberon de son bébé, elle s’enflamma après avoir remis du fuel dans le four et en mourut.
H. Spemann lui, a reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine, en 1935, principalement pour avoir découvert l’existence d’un mécanisme organisateur de l’embryogénèse – appelé plus tard « l’organisateur de Spemann ».
Pendant les dizaines d’années suivantes, beaucoup de tentatives ont été faites pour isoler ce principe d’organisation des cellules. Les résultats se sont révélés paradoxaux. L’"organisateur " de Spemann s’avérait introuvable. Les cellules nerveuses semblaient proliférer sous la commande de gènes qui fonctionnaient comme un programme informatique. Mais on a découvert ensuite la présence d’une substance qui stoppe la fabrication cérébrale : la protéine morphogénétique osseuse (BMP). Si le gène qui code cette substance n’est pas activé, un cerveau géant a tendance à se développer. La BMP limiterait ainsi la progression neuronale dans les parties latérales du cerveau, afin de favoriser le développement de la peau. D’autres substances inhibent le BMP au cœur de la plaque neurale pour mettre en place le tube neural. Ce sont la noggine et la chordine, et elles correspondent peut-être à l’organisateur de Spemann.
La protéine
Sonic Hedge Hog
La notochorde joue un rôle important dans la transformation de certaines cellules en neurones moteurs, c’est-à-dire en cellules nerveuses responsables des mouvements musculaires. C’est la protéine Sonic Hedge Hog (SHH) qui déclenche cette transformation. Elle aurait une fonction essentielle dans la plupart des processus à l’origine du cerveau.
Au cours du développement, la ligne nerveuse qu’est la notochorde deviendra le tube neural. Ce tube se refermera par le milieu, comme une fermeture Éclair. Cette étape très importante survient un mois après la fécondation. Si le tube n’est pas tout à fait fermé en haut, il y aura une anencéphalie (absence de cerveau) ou une encéphalocèle (hernie du cerveau qui se développe hors de la boîte crânienne). S’il ne se ferme pas en bas, cela causera un spina-bifida. Dans une certaine mesure, l’acide folique, que l’on recommande aux femmes avant qu’elles soient enceintes, prévient ces réactions.
200 000 nouvelles cellules nerveuses par minute
Le cerveau se forme par le gonflement de l’extrémité du tube neural. Cela s’apparente au gonflement d’un ballon ovale. Trois enflures apparaissent et forment les cavités, ou les ventricules du cerveau, remplis de liquide cérébro-spinal. Ce processus est initié par une protéine spéciale fabriquée par le gène Sonic Hedge Hog, qui est important dans la fabrication du cerveau primitif. Si l’effet de ce gène est bloqué, il n’y a pas de gonflements et le cordon nerveux restera un fil, comme chez les vers. Le nom de ce gène fait référence à un personnage de jeu vidéo. Il est également responsable de la formation des ailes chez les insectes, des jambes chez les mammifères et de la différenciation de certaines cellules nerveuses en neurones moteurs (c’est-à-dire en cellules nerveuses qui contrôlent les mouvements musculaires). Il est dit lâche, parce qu’il forme un certain nombre de connexions flottantes selon ce qui est avantageux dans un temps et un espace donnés. Les cellules nerveuses prolifèrent à une vitesse incroyable entre les troisième et cinquième mois de la vie fœtale. Chaque minute, 200 000 nouveaux neurones, issus des parois intérieures des cavités (ventricules) du cerveau, se forment, soit plus de 3 000 par seconde !
Chaque cellule-souche expulsée de la couche cellulaire se divise. Sa progéniture se spécialise en cellule nerveuse et ne peut plus redevenir indifférenciée. Parallèlement, le second rejeton de cette cellule mère restera une cellule-souche, réintégrera la couche cellulaire et pourra recommencer un nouveau cycle. Une vingtaine de cycles produiront en tout 100 milliards de cellules nerveuses. Puis ce Big Bang cérébral s’arrêtera. La neurogenèse (naissance de cellules neuronales) n’a plus lieu après la naissance, sauf dans le cervelet ou dans certaines zones du cortex très spécifiques comme celles liées à l’odorat.
Comment savons-nous tout cela ? Grâce à des recherches désormais classiques menées en Angleterre, qui ont démontré que la prolifération cellulaire plafonne entre les troisième et cinquième mois chez les fœtus avortés. De plus, on a observé que les fœtus exposés à de fortes radiations, comme après les explosions atomiques de Hiroshima et de Nagasaki, ont donné naissance à des cas de microcéphalies, ce qui n’est pas le cas s’ils ont été exposés durant une autre période. D’autres preuves ont été présentées par Pasco Rakic, un neurologue américano-croate. Ayant étudié la médecine à Belgrade, il a pu faire sa thèse sur le développement du cerveau à partir d’enquête sur les fœtus avortés – il était aisé de s’en procurer pendant l’ère communiste. Immigré ensuite aux États-Unis, il a mené des études importantes sur le développement du cerveau des singes. En leur administrant une substance radioactive qui s’incorpore dans l’ADN, il s’est rendu compte que l’essentiel du processus de division cellulaire a lieu avant la naissance.
Pourquoi conserve-t-on
sa personnalité ?
Jusqu’à récemment, il était admis par nombre de revues et d’ouvrages que tous les neurones se forment avant la naissance chez l’humain. À la différence des autres cellules qui se renouvellent en permanence, on garde tout au long de notre vie les mêmes neurones. Ce dogme a pourtant été remis en cause à partir des années 1980, quand Fernando Nottebohm, agronome originaire d’Argentine, démontre que de nouvelles cellules nerveuses pouvaient se former dans le cerveau adulte : il faut dire qu’il s’agissait du cerveau d’oiseaux des îles Canaries. Chez ces espèces, le nombre de nouvelles cellules nerveuses est lié au répertoire de chants disponibles. Ce fut une découverte révolutionnaire allant à l’encontre d’un dogme bien ancré en neurosciences, qui affirmait que tous les neurones se forment avant la naissance. La découverte de F. Nottebohm a pourtant été confirmée et étendue au cerveau humain adulte. Cette découverte a d’ailleurs servi de support à des campagnes publicitaires en faveur de nouveaux traitements des maladies de Parkinson et d’Alzheimer, qui consisteraient à stimuler la prolifération des cellules nerveuses dans les régions endommagées du cerveau.
Cela dit, même si de nouvelles cellules nerveuses peuvent émerger durant la vie adulte dans les parties basses du cerveau, presqu’aucun nouveau neurone ne se forme dans le cortex cérébral. C’est dommage, mais c’est aussi pourquoi on peut conserver de vieux souvenirs et sa personnalité jusqu’à un âge avancé.
Les cellules nerveuses migrent en direction des parties supérieures et latérales de la tête, le long des fils des cellules gliales – qui jouent le rôle de support dans le cerveau. Ces fils fonctionnent comme des cordes suspendues sur un échafaudage. Les cellules nerveuses grimpent le long de ces cordes. Au début elles forment une sous-plaque, puis elles entrent dans le cortex entre la 22e et la 24e semaine de gestation. Ce processus d’invasion et de migration cérébrale est beaucoup plus impressionnant chez le fœtus humain que chez n’importe quel autre mammifère. Cette explosion de cellules nerveuses envahissant la partie supérieure de la tête est probablement due à une mutation apparue il y a environ deux millions d’années, avec l’apparition de l’espèce humaine. Cela peut expliquer pourquoi le cortex humain est beaucoup plus étendu que celui du singe et peut faire fonctionner des mécanismes complexes comme la pensée symbolique ou le langage.
L’étape suivante de formation du cerveau consiste à créer des connexions entre cellules. Le principal embranchement de chaque cellule – l’axone – est accompagné de plusieurs petites branches, les dendrites. Au bout de ces connexions, les synapses mettent en contact les cellules nerveuses entre elles. Chaque cellule nerveuse comporte entre 1 000 et 10 000 synapses. Entre la 6e et la 8e semaine de gestation, elles commencent déjà à se former et, à partir de la 20e semaine, leur développement s’accélère. La synaptogenèse atteint son point culminant dans le cerveau humain entre la première et la troisième année de vie. Cette synaptogenèse est également impressionnante : à chaque seconde se créent plus d’un million de synapses ! Ces connexions synaptiques se produisent dans l’enfance, au moment où le cerveau fonctionne comme un aspirateur qui capte tous les nouveaux mots du langage auquel il est exposé. Les mots appris pendant l’enfance, ainsi que tous les autres souvenirs, sont conservés par le biais de liaisons synaptiques. La synaptogenèse, très intense durant toute l’enfance, diminuera ensuite pendant l’adolescence. Voilà pourquoi, après la puberté, il sera difficile d’apprendre un nouveau langage sans avoir d’accent. Mais l’on peut apprendre de nouveaux langages et beaucoup d’autres choses à l’âge adulte, puisque la synaptogenèse continue jusqu’à la vieillesse, même s’il devient beaucoup plus difficile d’apprendre au fur et à mesure que l’on avance en âge.
Apprendre, c’est éliminer
Les milliards de cellules nerveuses et leurs milliards de milliards de connexions et de synapses ressemblent, jusqu’à la fin de la vie fœtale, à une jungle. Différentes parties du cerveau sont connectées par plusieurs chemins sinueux. Des connexions se forment entre des aires cérébrales où toutes sortes de données sensorielles sont traitées : par exemple entre les aires qui traitent la vision et l’audition.
Le cerveau immature ressemble au Vieux Paris, avec un grand nombre de petites rues sinueuses et de portes. Il existe une surabondance de cellules nerveuses et de connexions. Mais heureusement des mécanismes vont venir organiser cette jungle. De la même manière qu’Eugène Haussmann a dû démolir plusieurs maisons pour construire les grands boulevards, des milliards de cellules nerveuses et leurs connexions disparaissent par apoptose (ou mort cellulaire). Cette mort cellulaire programmée est un processus important durant le développement en général : c’est un processus de destruction qui se passe par exemple quand les palmes entre les doigts et les orteils du fœtus disparaissent. Cette mort cellulaire agit sous l’action de certains gènes destructeurs qui sont activés au cours du développement.
Dans le cerveau, la centaine de milliards de cellules nerveuses diminuent presque de moitié à la naissance. Dans une certaine mesure, cette disparition est génétiquement déterminée, mais elle est également affectée par des processus liés à l’environnement. Les nerfs qui sont stimulés par les organes sensoriels par exemple grandissent mieux et développent plus de branches et de synapses. Les nerfs qui ne sont pas stimulés disparaissent.
On sait que les enfants nés avec une cataracte doivent être opérés aussi vite que possible pour ne pas devenir aveugles. Car le cerveau immature doit être stimulé par des impressions visuelles très tôt pour apprendre à voir. On parle de « période critique » ou de « fenêtre d’opportunité » pour désigner ce moment où le cerveau doit être stimulé pour favoriser à la fois la survie des connexions les plus appropriées et l’élimination de celles qui sont inutiles. En somme : « Apprendre, c’est éliminer ».
De jeunes gens impulsifs,
la faute à la myélinisation ?
Le trafic d’impulsions nerveuses est assez lent dans le cerveau du fœtus. Pour augmenter leur vitesse, la gaine nerveuse – la myéline – se met en place. On peut la comparer au matériel d’isolation électrique entourant des câbles en cuivre, à la différence que la gaine de myéline est interrompue à plusieurs endroits, ou nœuds. La myélinisation est un processus important qui commence dès la 23e semaine avec les cellules nerveuses les plus volumineuses. On dit en effet qu’elle fonctionne de manière pyramidale (du plus gros au plus fin) et se poursuit pendant toute l’enfance. Les nerfs les plus fins sont myélinisés beaucoup plus tard. Les dernières petites cellules nerveuses à être myélinisées sont ce que l’on appelle les interneurones, et sont situées dans la partie antérieure du cerveau. Ce processus survient parfois tardivement dans l’adolescence, voire à l’âge de 30 ans. Cette myélinisation tardive des nerfs se situe dans le lobe frontal, là où se produisent les processus mentaux décisionnels. Cela peut expliquer le fait que les adolescents ont parfois des difficultés à décider efficacement de l’acte à accomplir et que les jeunes gens soient plus impulsifs que leurs aînés.
L’IRM présente la myélinisation sous la forme d’une matière blanche et on peut voir que l’épaisseur de la matière blanche augmente dans le cortex pendant l’enfance et l’adolescence.
Nature ou culture ?
Non, nature et culture
Dans quelle mesure le développement du cerveau est-il déterminé par les gènes (la nature) ou l’environnement (la culture) ? Le programme de cartographie du génome humain, initié au début des années 2000, a été réalisé avec l’idée que les gènes jouaient un rôle majeur dans un certain nombre de comportements. Et qu’on pourrait bientôt trouver les gènes responsables de troubles comme le trouble déficitaire de l’attention (ADHD), l’hyperactivité, l’intelligence, la timidité, la dépression, l’alcoolisme. Pourtant, même s’il existe des gènes qui augmentent le risque de développer certains comportements, les facteurs environnementaux jouent également un rôle important. Des chiots négligés par leurs maîtres ont des difficultés quand, une fois adultes, on teste leurs aptitudes cognitives. Ces animaux sont également plus sensibles au stress. Mais on a surtout découvert récemment que le génome est lui-même altéré pendant les périodes sensibles des premiers temps du développement.
En résumé, le développement du cerveau est déterminé initialement par des gènes spécifiques qui développent le tube neural, les cellules nerveuses puis la migration cellulaire. Les embranchements nerveux et la synaptogenèse sont également génétiquement déterminés au départ. Cependant, à partir du troisième trimestre de gestation, c’est-à-dire de la troisième partie de la vie fœtale, l’activité nerveuse, elle-même liée aux stimulations internes et externes, joue un rôle plus important dans la construction des synapses et des circuits nerveux. C’est encore plus vrai après la naissance. Comme l’a remarqué Jean-Pierre Changeux, il est difficile de croire que la structure du cerveau, avec 100 milliards de cellules nerveuses, comportant chacune 1 000 à 10 000 synapses, puisse être déterminée en détail par seulement 22 000 gènes.
Ainsi il n’est plus possible de penser le développement cérébral comme un programme entièrement déterminé à l’avance par la nature, ni entièrement façonné par la culture. Il faut apprendre à penser les relations cerveau-culture en terme de coproduction.
Le célèbre journal scientifique Nature a donné une nouvelle figure de l’ADN, incluant une autre spirale représentant l’hérédité culturelle afin de mettre en évidence son importance décisive dans le développement humain.
http://www.scienceshumaines.com/la-fabrication-du-cerveau_fr_26045.html
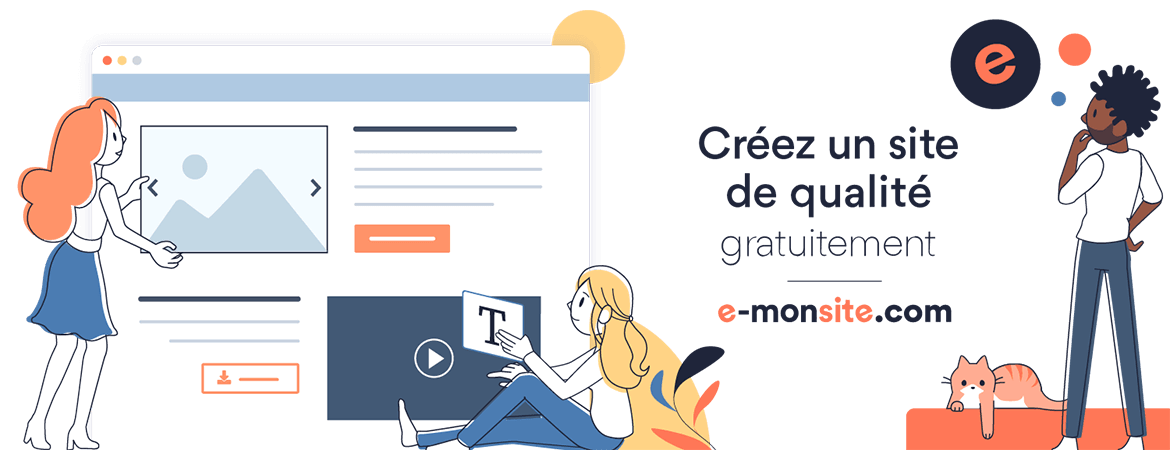
1. Par Mehdi El le 2025-04-10
Bon travail Merci
2. Par wassim le 2024-02-26
tres bien
3. Par fistone le 2023-07-09
Bon courage
4. Par mouna el achgar le 2023-07-09
je suis une enseignante de la langue française et cette année je vais enseigner pour la première fois ...
5. Par Salwa le 2023-03-18
Merci
6. Par Rbandez le 2022-11-19
Trés Bon resumé
7. Par Rbandez le 2022-11-19
Trés Bon resumé
8. Par El otmani le 2022-11-01
Bonjour Merci pour votre exemple je le trouve vraiment intéressant Auriez-vous un exemple pour une ...