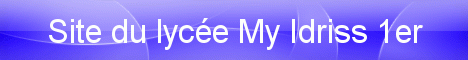 referencement sur bing - référencement de site web gratuit -
referencement sur bing - référencement de site web gratuit -
Aujourd’hui, tout le monde est conscient de la dégradation et du recul de système éducatif au Maroc. Quelles en sont les causes et comment peut on y remédier?
;;;;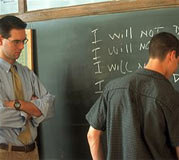
Un système disciplinaire léger est plus efficace
La psychologie sociale a montré, en matière de discipline, que le fait d'amener les sujets à se soumettre librement, par consentement, agit fortement et positivement sur les modifications des comportements, dans une perspective favorable à la vie du groupe et à l'évolution et l'efficacité des personnes. Par ailleurs, moins elles se sentent menacées, plus elles s'investissent dans le contexte qui leur est proposé. Pour amener des élèves à se mobiliser dans un cadre donné, il apparaît qu'un système disciplinaire léger est plus efficace qu'une lourde batterie de sanctions qui va limiter l'acceptation de l'autorité à l'obéissance complaisante.
;;;;;• La discipline: un facteur favorisant la mise en place des projets collectifs et individuels
La discipline doit faire agir par soi et non par ordre. Cette dernière approche est déresponsabilisante et place ceux qui devraient être auteurs de la discipline dans un statut de victime qui les éloigne totalement du processus. La discipline doit être finalisée, et par là démystifiée, et quitter son statut de prise de pouvoir sur les autres. Elle doit apparaître comme étant une nécessité visant à « ordonner dans un groupe un jeu modéré des rapports et des protections, des influences et des contraintes ». La discipline est par là un facteur favorisant la mise en place des projets collectifs et individuels. C'est en ce sens que les règles, le contexte disciplinaire doivent être élaborés avec les élèves et surtout rappelés à l'amorce de tout nouveau projet.
;;;;;• Distinguer la discipline de l'action de discipliner
Il s'agit de distinguer la discipline de l'action de discipliner, les deux termes ne recouvrant pas les mêmes notions. La discipline fait référence à l'ordre, au respect des règles, à la prise en considération d'autrui, autant de notions que l'on ne peut mettre en cause, alors que le fait de discipliner évoque l'idée d'assujettir et de soumettre. Thomas Gordon distingue la discipline instructive, qui s'attache à influencer l'autre, de celle dite restrictive, qui va limiter ses prérogatives. Et ici, la psychologie nous vient en aide, démontrant que plus on cherche à dominer les gens par le pouvoir, moins on peut influencer leur vie. La discipline ne doit pas prétendre à une obéissance stricte et immuable.
Il s'agit d'accepter le refus d'obéissance car si celle-ci devient une exigence incontestable, elle peut susciter une rancune inconsciente qui à plus ou moins long terme, risque de conduire à une contestation ouverte et généralisée. Il faut admettre la désobéissance en tant que principe et l'accepter quand elle porte sur des orientations accessoires ou formelles.
Par la discipline instaurée, l'enseignant devient le garant de cette possibilité d'être soi et ensemble. Il pose ainsi le principe et le fondement de cette discipline, le contrat en lui-même dont la mise en place passe par les nécessaires étapes suivantes :
- découverte des intérêts communs à trouver des règles ;
- reconnaissance de celles-ci par le discours qu'elles engendrent, les élèves y mettant des mots, leurs mots, afin d'actualiser les concepts ;
- mise en pratique et régulation permanente du règlement et de ce qu'il implique, la discipline dans ce contexte ne pouvant être figée mais sans cesse matière à regard et à parole.

;
• La punition
L'éducation, qu'elle soit scolaire ou autre, parce qu'elle vise avant tout à donner confiance en soi et à rendre autonome, ne peut reposer sur un rapport de force, sur l'humiliation, sur la peur. Ce qui interroge nécessairement la notion de punition, laquelle se traduit par tout un arsenal de mesures allant des privations diverses aux mises à l'écart en passant par les multiples pensums.
Aident-elles vraiment à faire intégrer la loi, à mieux faire cohabiter les désirs de l'élève, ses « modes de fonctionnement » avec les exigences de la vie scolaire ? Tout dépend bien sûr du contexte qui suscite la punition. Si elle résulte de l'exaspération de l'adulte, elle peut « calmer le jeu » un temps durant, mais ne résoudra pas le fond du problème qui est à son origine et empêchera encore moins la récidive. L'élève perçoit rapidement que son origine est plus liée à l'humeur de l'adulte, donc quelque peu subjective, qu'à un contexte. Il est vrai aussi que punir n'est pas toujours neutre.
Cela peut vouloir dire « faire payer », des mécanismes de transfert pouvant interférer dans le fondement même de la punition – qui punissons-nous au travers de l'élève ? Le fondement de la punition peut être l'envie, le ressentiment. Punir peut par ailleurs relever d'un mode de communication défaillant. On sait également que la punition est susceptible d'être recherchée par l'élève parce qu'elle peut constituer une marque de reconnaissance, parce qu'elle légitime une culpabilité forte en lui.
;;;;;• La sanction
La sanction quant à elle appelle un tiers médiateur : c'est le code, la règle, la charte-qui vont « objectiver" la situation empêcher l'arbitraire et par là légitimer l'acte. Elle établit un lien clair entre ce qui est répréhensible et la peine. Contrairement à la punition, qui peut ouvrir sur la contestation, et éventuellement appeler à renchérir la peine, la sanction induit la notion de recours. Elle s inscrit aussi dans un étalonnage et une hiérarchie de la peine.
Les récents États généraux de la sécurité à l’Ecole en ont montré les abus et les limites. Une étude indique tout d’abord que 17 000 élèves étaient exclus définitivement chaque année de leur établissement et 367 000 pour un ou plusieurs jours (1).
L'ampleur du phénomène interpelle :
« Chaque jour de classe, 95 collégiens ou lycéens sont définitivement exclus de leurs établissements et plus de 2 000 écartés temporairement.(2) »
L'exclusion est tout d'abord un marqueur d'échec qui est aussi un aveu d'impuissance, peut-être d'incompétence ou d'un manque de flexibilité éducative au sein d'un établissement.
Comment lire autrement un des constats de l'enquête citée, qui montre que plus un chef d'établissement a d'ancienneté, moins il exclut ? En tout état de cause, l'exclusion, qu'elle soit temporaire ou définitive, provoque rarement une prise de conscience, laissant plutôt l'élève dans une forme de désarroi que peut amplifier le sentiment d'injustice. Elle peut même être en cela génératrice de rancœur qui va conduire l'élève à un mécanisme de récidive. Tout simplement parce que le sentiment de rejet affecte l'image de soi et peut générer un « effet Pygmalion » ; l'élève, se sentant désigné et stigmatisé, va s'attacher à correspondre à l'image de soi qui lui est renvoyée par l'exclusion.
;;;;;• Une sanction constructive
La sanction reste une modalité de réponse à la violence mais elle doit conserver une fonction éducative. Pour ce faire, elle ne doit pas être considérée comme une fin en soi. Elle a plusieurs fonctions : elle doit d'abord signifier la fin de la violence. Ensuite, elle attribue au sujet concerné la responsabilité de ses actes.
La sanction doit permettre de faire référence à un consensus collectif figé qui aura été négocié, bâti sur du sens et sur le dialogue, fixant la nécessité de règles pour asseoir la vie collective et les apprentissages.
A partir de là, la sanction doit être immédiate pour qu'il n'y ait pas de contestation possible et que le rapport puisse être établi directement entre le fait incriminé et le référentiel ou le contrat de discipline. Elle doit être aussi effective : les menaces, les reports diminuent la force de la sanction, la crédibilité de l'adulte et par là son autorité.
La sanction doit être rare pour être efficace et avant tout constructive : elle doit pour ce faire avoir du sens et participer à l'apprentissage ou au processus éducatif. De ce fait, elle ne doit pas avoir un caractère gratuit ou humiliant. En aucun cas, la sanction ne doit exclure l'élève du groupe classe et de ses activités. Elle a par essence une fonction d'amélioration de l'intégration de l'élève dans un processus, qu'il soit d'organisation ou de fonctionnement ou proprement d'apprentissage et face auquel il se montre défaillant.
Individuelle par nature - la sanction collective exacerbe le sentiment d'injustice, en même temps qu'elle va provoquer inévitablement des fissures dans l'entité du groupe -, la sanction doit toujours rester proportionnelle à sa cause. Pour l'élève, le fait d'être sanctionné doit marquer davantage que la nature propre de la sanction.
Enfin, une sanction doit toujours être accompagnée d'un dialogue afin qu'elle ne soit pas ressentie comme exclusion ou rejet. En matière de récompense, il faut savoir que « la récompense inféode bien davantage que la punition (3) » et que son recours lui aussi doit être déterminé par le contexte d'un contrat.
(1) Enquête réalisée par Georges Fotinos avec le soutien de la MGEN et de la CASDEN.
(2). Le Monde, 7 avril 2010.
(3) Marsal M. (1958). L'Autorité, Paris, PUE
http://apprendreaapprendre.com/reussite_scolaire/article.php?numtxt=1069
Bac : qui est Myriam Bourhail, la meilleure... par francetvinfo
J'ai eu des profs géniaux.
Myriam Bourhail a eu 21,03 de moyenne au bac S. Une grande surprise pour elle.
J'ai 18 ans et j'ai eu 21,03 de moyenne au bac scientifique. Je suis agréablement surprise, et pour tout dire, plutôt étonnée. Non pas que j'avais de mauvaises notes pendant l'année, mais je tournais autour de 18 ou 19 de moyenne.
21, c'est vraiment surprenant. J'ai eu une mention très bien avec les félicitations du jury, même si je crois que le terme n'existe plus vraiment.
Mes notes ? 20, 19, 18…
J'ai eu 20 dans les matières scientifiques, en anglais, espagnol, grec et français. En philo, j'ai eu 19, 18 en histoire… et ma plus mauvaise note, c'est en sport que je l'ai obtenue : j'ai eu 15.
En philo, j'ai pris la dissertation "Vivons-nous pour être heureux ?". Alors évidemment, j'ai parlé du bonheur, que ce n'était pas une fin en soi, mais une étape. J'ai philosophé, comme dans la vie de tous les jours, en fait. C'était effectivement une question que je m'étais déjà posée.
Je suis fille d'ouvrier mais ...
Mon papa est ouvrier et ma mère ne travaille pas. Ils sont évidemment très fiers de moi et on va fêter ça tous ensemble bientôt. Mais quand les médias parlent de la "bachelière issue d'un milieu ouvrier", je trouve ça réducteur. Pourquoi toujours mettre en avant le milieu social, et pas le travail ? C'est plutôt ça qui prime.
J'ai travaillé dur tout au long de l'année, je n'ai pas révisé au dernier moment pendant une semaine de façon intensive. J'ai fait énormément d'exercices avec les professeurs, de nombreuses relectures…

J'ai quand même réussi à profiter de mon année
Mais n'allez pas croire que je sois restée enfermée dans ma chambre pour bachoter ! J'ai aussi eu le temps de profiter, en sortant avec des amis, et avec ma famille.
Mes camarades de classe sont très contents pour moi. Ils m'ont beaucoup félicitée. Il n'y a aucune jalousie. Avoir de bonnes notes durant ma scolarité n'a jamais été difficile dans mon cas. Cette année, on s'est tous soutenus.
J'ai eu des profs exceptionnels
Cette réussite, je la dois à mon travail, oui, mais aussi aux professeurs de mon établissement, le lycée européen Villers-Cotterêts. Ils ont été très bons pour nous préparer. Ils ont toujours été là, très impliqués, à faire des heures supplémentaires, notamment mon principal, qui est passionné par son travail
C'est beau à voir.
Maintenant, j'aimerais bien tenter médecine. J'aimerais bien devenir chirurgien ou pédiatre. J'ai toujours voulu faire ça.
Propos recueillis par Audrey Kucinskas
 Usages de la carte mentale Usages de la carte mentale |
|
 Étapes de création Étapes de création |
|
 Une carte réalisée à la main ou avec un logiciel ? Une carte réalisée à la main ou avec un logiciel ? |
|
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/projet/cartes_m/mental_1.htm
Ce qu’il faut retenir :
Sur le plan intellectuel : Etre surdoué ne signifie pas être quantitativement plus intelligent mais penser dans un système qualitativement différent. Ce sont les formes spécifiques de son intelligence qui distinguent le surdoué. Etre surdoué ne signifie pas être seulement plus intelligent que les autres mais fonctionner avec un mode de pensée et une structure de raisonnement singuliers. C’est cette particularité qui rend parfois difficile son adaptation scolaire mais aussi son adaptation sociale.
Sur le plan affectif :
Etre surdoué c’est aussi et peut-être surtout, présenter des particularités dans la construction psychologique: grandir avec une hypersensibilité, une affectivité envahissante, qui marquent la personnalité. Le diagnostic de surdoué ne peut se résumer au chiffre réducteur de QI. Aider et accompagner l'enfant dans son développement c'est comprendre l'ensemble de son fonctionnement sur les plans intellectuel et affectif et resituer l'efficience intellectuelle dans une dynamique globale.
Et puis, s'il était utile d'insister, n'oublions jamais qu'un enfant surdoué est d'abord un enfant. Même si tous les enfants surdoués présentent des caractéristiques communes qu'il faut savoir repérer et distinguer pour apporter une aide adaptée, l'enfant a son histoire personnelle, il appartient à une dynamique familiale, sociale, qui est la sienne.
La démarche diagnostique :
Poser un diagnostic est une démarche clinique complexe. Elle s’appuie à la fois sur l’observation de l’enfant, sur l’analyse de la situation actuelle et passée, sur la compréhension de l’histoire familiale et de l’histoire de l’enfant.
Le bilan psychologique complète et enrichit la démarche à l’aide d’une exploration attentive du fonctionnement intellectuel et cognitif et de l’intrication avec la sphère affective de la personnalité. Il s’agit toujours de resituer l’enfant dans une perspective globale et dynamique.
Sur un plan psychométrique :
on parle de surdoué lorsqu’un QI (Quotient Intellectuel) global de 130 ou plus est obtenu sur une échelle d’efficience intellectuelle. En France, comme dans le monde, les échelles les plus utilisées sont les échelles de Wechsler. Il en existe trois versions WPPSI pour les moins de 6 ans, WISC jusqu’à 16 ans, WAIS pour les adultes. (pour plus de précisions sur ces tests vous pouvez vous reporter à la rubrique Bilan Psychologique du site). A souligner: la dernière version du WISC (WISC IV) et de la WAIS (WAIS IV) ne présente pas les mêmes profils que les versions précédentes. Son interprétation doit impérativement être approfondie et s’appuyer sur l’ensemble des indices tant cognitifs que cliniques afin d’éviter toute erreur diagnostique.
Prudence : Un QI N’EST PAS un diagnostic. C’est un indice qui oriente le diagnostic. Le score n’a pas de valeur en soi. Une donnée chiffrée ne suffit JAMAIS. Un diagnostic de surdoué ne peut être posé qu’avec l’appui des éléments cliniques et les données de bilans complémentaires. C’est un diagnostic global.
http://www.cogitoz.com/PI.aspx?PLinkId=28&PT=100
D’abord, juste pour vous rassurer, sachez que de nombreux étudiants-stagiaires vont achever, courant juin, leur stage obligatoire. Des places vont se libérer ! Même début juillet, il sera encore temps de trouver un stage. C’est maintenant que les entreprises vont commencer à chercher, pour les mois de juillet et août, voire septembre, de bonnes volontés avides d’apprendre pour combler les postes dévolus aux stagiaires. L’activité étant souvent ralentie au cours de la période estivale, c’est peut-être le meilleur moment pour faire un stage productif, au cours duquel votre tuteur sera disponible pour vous faire partager son savoir.
Oui, mais comment faire ?Un stage, vite fait, bien fait !
Premier bon plan : mettez vos professeurs à contribution ! N’oubliez pas qu’ils appartiennent eux-mêmes à un réseau et disposent souvent d’un carnet d’adresses assez riche, qui plus est dans la branche qui vous intéresse. Mettez en avant votre motivation, insistez en suggérant que c’est fondamental pour votre expérience, que vous serez à la hauteur. Pensez à vos collègues étudiants - d’autant plus ceux dont le cursus exige un stage obligatoire : leur recommandation, si leur stage s’est bien passé, aura une certaine valeur auprès de l’entreprise. Par ailleurs, ils pourront vous dire si le jeu en vaut la chandelle.
Certes, l’heure n’est plus aux salons étudiants-entreprises. Mais il reste des moyens valables toute l’année pour trouver un stage. Déjà, pensez au BDE (bureau des étudiants) de votre fac, qui peut être une mine d’informations et de bons plans. Sinon, il existe sûrement un service des stages sur votre campus. Vous pouvez vous y rendre et vous enquérir de conseils, contacts ou offres de stages éventuelles.
Rendez-vous aussi dans les organismes qui s’occupent de vie étudiante. LeFP Taroudant , qui dépend du ministère de la Jeunesse et des Sports, vous donnera accès à des offres de stage, et aussi : www.optioncarrière.ma. Le CIDJ gère un réseau d’information jeunesse avec des bureaux implantés « près de chez vous ». Dans la rubrique du même nom, sur le site internet, vous trouverez d'autres adresses très utiles ! Vous pouvez d’ailleurs vous renseigner auprès des associations étudiantes de votre région...
Comme vous le savez sûrement, il existe pour chaque branche d’activité, des fédérations professionnelles qui travaillent notamment au développement économique des entreprises du secteur. Celles-ci disposent d’annuaires professionnels (des entreprises adhérentes bien sûr !).
Vous pouvez demander à les consulter au siège de la fédération qui vous intéresse ou parfois y avoir directement accès sur les sites internet. Quoi qu’il en soit, c’est une excellente source d’information et de conseil ainsi que les adresses de différentes fédérations régionales de travaux publics. Alors, quel que soit votre secteur d’exercice - bois, chimie, audiovisuel, agroalimentaire, habillement, hôtellerie, édition... - renseignez-vous ! Si vous cherchez l’annuaire de référence des entreprises, il y a un nom à retenir : le Kompass. Les entreprises y sont répertoriées par secteur d’activité, entre autres modes de recherche.
Rien ne vous empêche de consulter aussi les pages jaunes. Mais ciblez votre recherche, surtout quand le temps presse !
Tout corps de métier a ses revues spécialisées qui traitent des dernières news et avancées du secteur. Logiquement, au cours de vos études, on a dû vous informer sur celles qui vous concernent : Livres Hebdo pour les métiers du livre par exemple. Des offres de stage et d’emploi y sont toujours publiées. Mais attention, vous ne serez pas le seul petit malin à y jeter un œil ; alors dépêchez-vous de répondre et rappelez l’entreprise pour savoir où en est votre candidature, cela prouvera votre intérêt.
Enfin, pensez à la presse économique ou aux suppléments emploi des quotidiens ou hebdomadaires.
Adeptes du web, vous devez savoir que de plus en plus de sites spécialisés en offres de stage ou d’emploi fleurissent sur la toile. Pour n’en citer qu’un, celui-ci, où vous pouvez trouver des offres comme déposer votre demande !
Si vous n’avez toujours pas trouvé, il ne vous reste plus qu’à consulter directement les sites internet des grandes entreprises privées ou publiques. Elles constituent souvent un vivier d’offres de stages. Mais attention, les grands groupes sont souvent très exigeants en matière de recrutement. Une candidature dynamique à une PME, où vous expliquez CLAIREMENT que vous cherchez un stage, pourrait bien faire plus facilement mouche...
En désespoir de cause, et ce n’est peut-être pas le pire des "tuyaux" que l’on peut vous donner, faites marcher vos relations ! La famille et les amis, il n’y a que ça de vrai... Vous aurez bien le temps ensuite de trouver un stage par vos propres moyens, pour l’instant, l’urgence décide...
Liens utiles:
http://www.mchomi.com/
http://www.tanmia.ma/rubrique.php3?id_rubrique=110
http://stage.etape.ma/
Source:http://www.studyrama.com
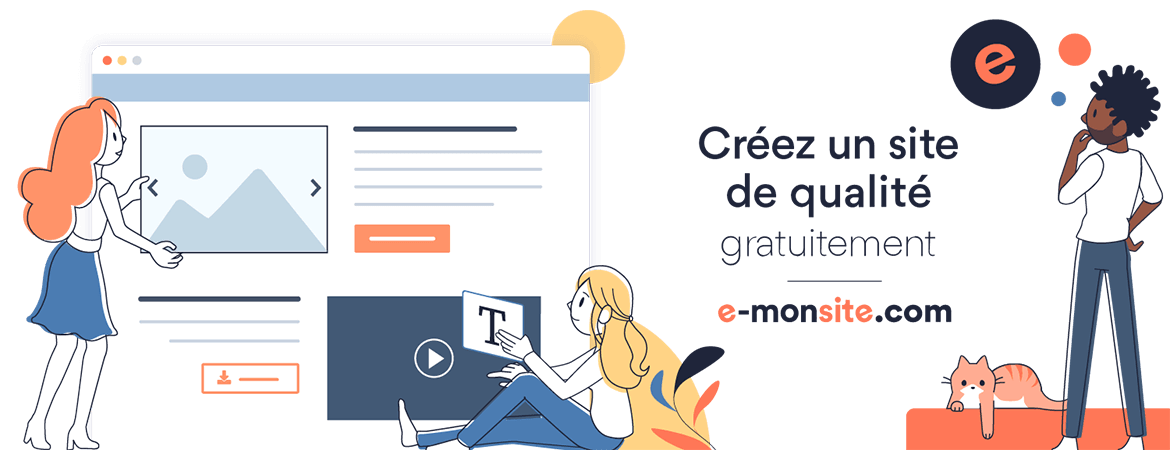

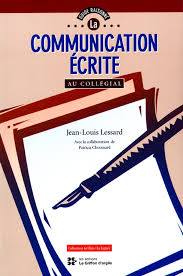
 La carte mentale (mind map) est un outil qui m'aide à cerner et à organiser tout ce que je sais déjà sur un sujet. Elle représente la manière dont je pense. Grâce à cette structure, je visualise et je contrôle mieux mon sujet.
La carte mentale (mind map) est un outil qui m'aide à cerner et à organiser tout ce que je sais déjà sur un sujet. Elle représente la manière dont je pense. Grâce à cette structure, je visualise et je contrôle mieux mon sujet.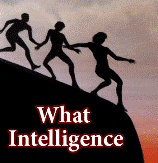
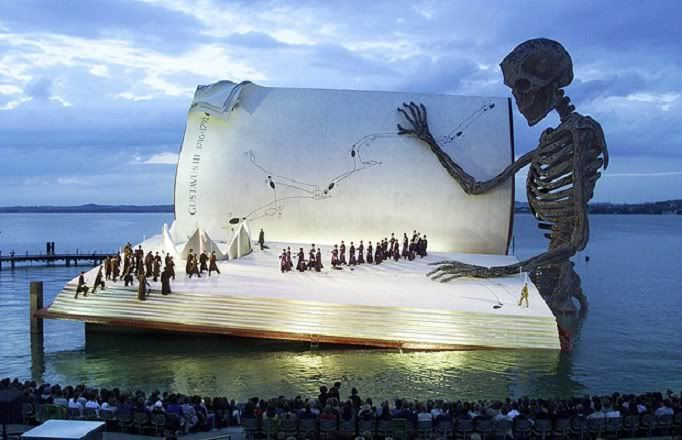
1. Par Mehdi El le 2025-04-10
Bon travail Merci
2. Par wassim le 2024-02-26
tres bien
3. Par fistone le 2023-07-09
Bon courage
4. Par mouna el achgar le 2023-07-09
je suis une enseignante de la langue française et cette année je vais enseigner pour la première fois ...
5. Par Salwa le 2023-03-18
Merci
6. Par Rbandez le 2022-11-19
Trés Bon resumé
7. Par Rbandez le 2022-11-19
Trés Bon resumé
8. Par El otmani le 2022-11-01
Bonjour Merci pour votre exemple je le trouve vraiment intéressant Auriez-vous un exemple pour une ...