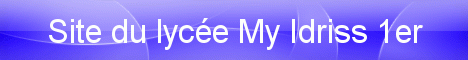 referencement sur bing - référencement de site web gratuit -
referencement sur bing - référencement de site web gratuit -

Il y a plus d’une bonne ou mauvaise raison de ne pas aller à l’école, mais depuis le milieu des années 2000, il en est une qui se développe: la « phobie scolaire ».
Au plus simple, c’est un comportement de refus angoissé de l’école chez l’adolescent. Selon une étude ancienne, les deux tiers des cas reconnus seraient précurseurs de troubles névrotiques, voire psychotiques chez l’adulte. Oui, mais voilà : psychiatres, médecins et pédagogues s’interrogent sur l’utilité d’une telle catégorie pathologique, car on ne sait pas trop à quelle cause l’attribuer.
Plusieurs thèses se partagent l’explication du phénomène. Une phobie suppose une causalité endogène. Dans le cas présent, ce serait une angoisse spécifique d’avoir à apprendre, ou d’être incapable de le faire. Selon d’autres psychiatres, ce serait la crainte d’être confronté à autrui, voire la conséquence d’un harcèlement. Les auteurs anglo-saxons parlent de « refus scolaire », qui a peu à voir avec l’école, mais serait une forme tardive de l’angoisse d’être séparé de ses proches. À l’opposé, la cause peut être cherchée dans l’inadaptation du système scolaire, soit qu’on le juge anxiogène par nature, soit qu’on incrimine un moment de crise dans la transmission de la culture. Dans ce cas, on parle de « décrochage scolaire » et non de phobie.
Comme le souligne Philippe Mazereau, chercheur à l’université de Caen, le choix des mots est donc un problème. Celui des remèdes en est un autre. Or, son enquête montre deux choses. D’abord, il existe une demande croissante de diagnostic « phobique » de la part des parents, plus que des médecins. Ensuite, s’il n’existe pas de description consensuelle de la phobie scolaire, le diagnostic est déductible du traitement que l’on applique : s’il y a prise en charge psychologique et scolarisation à la maison, alors c’est bien une phobie scolaire, et non un autre trouble, qu’il soit de séparation ou lié à la « crise adolescente ».
Philippe Mazereau et al. (coord.),
« Phobie scolaire ou peur d’apprendre ? »,
La Nouvelle Revue de l’adaptation
et de la scolarisation, n° 62, juillet 2013.

L’autorité n’est ni naturelle ni uniquement statutaire. Elle peut s’acquérir en analysant les pratiques et les savoirs d’action que les enseignants mobilisent dans des situations critiques.
On estime souvent que certaines personnes possèdent une autorité naturelle et d’autres ne l’ont pas. À l’inverse, on considère aussi que l’autorité pourrait découler directement du statut et de la position de pouvoir occupé. Ce sont là deux mythes profondément ancrés dans les esprits.
Dans le domaine de l’éducation, on retrouve ces deux positions symétriques. Pour les uns, l’autorité est affaire de statut et de savoir : c’est donc de sa place dans l’institution et du savoir qu’il détient que l’enseignant tire son autorité. Pour d’autres, l’autorité est une affaire de personnes : il y a ceux qui « savent s’y prendre » avec les élèves et d’autres qui se laissent déborder. Ces deux positions ne satisfont ni le chercheur ni l’enseignant aux prises avec les difficultés quotidiennes.
Nous faisons l’hypothèse que l’autorité peut aussi s’apprendre, se développer, s’acquérir et se transmettre (1). Cet apprentissage doit s’appuyer notamment sur les « savoirs d’action » mis en œuvre par les enseignants eux-mêmes dans leur classe, savoirs d’action qu’ils acquièrent au fil du temps entre pairs et avec des formateurs lorsqu’ils analysent leurs pratiques dans des situations contextualisées. Pour mettre au jour ces savoirs effectivement mobilisés, nous avons mené une série entretiens avec des enseignants d’écoles maternelles et élémentaires, de collèges et de lycées (2). À partir d’un moment particulier de classe vécu où il a eu le sentiment d’avoir de l’autorité, chaque enseignant a fait le récit détaillé d’une situation précise où il s’est efforcé d’exercer son autorité dans une perspective éducative. Deux exemples, qui font partie du corpus recueilli au cours de notre enquête, vont nous permettre de mettre en lumière quelques caractéristiques de l’autorité éducative tel qu’on peut l’entendre et la pratiquer dans un cadre démocratique (3).
Francine enseigne en classe de CM1-CM2. Au cours d’une séance d’entraînement pour une manifestation sportive, trois élèves perturbent la course de relais. Devant composer des équipes pour cette épreuve et cherchant une réponse appropriée à l’attitude des trois élèves, l’enseignante décide de différer l’annonce de sa décision…
Le samedi qui précède la rencontre sportive, en fin de matinée, Francine évoque la composition des équipes du relais. Assise près de son bureau, elle s’adresse à la classe en commençant par indiquer la date de la rencontre. Elle prend ensuite le temps d’expliquer aux élèves qu’ils vont participer à trois épreuves. Francine parle également du relais, en insistant sur le fait qu’elle doit choisir huit élèves mais sans dire lesquels. Puis, elle explicite ses critères de choix : l’intérêt de l’équipe et la valorisation des efforts de certains élèves (des qualités morales), la vitesse de course (une qualité physique). Elle cible enfin à mots couverts les trois élèves. Ceux-ci réagissent : « Ah ben oui, c’est sûr que moi je serai pas pris. » Pour ne pas humilier d’autres élèves écartés, elle prend soin d’expliquer sa décision en justifiant son choix par les qualités physiques des élèves. À travers des paroles, des mouvements d’épaules et une grande écoute de la classe qui semblait attendre qu’elle réagisse, la professeure se dit qu’elle est soutenue. Quant aux trois élèves, Francine interprète leur absence de colère comme une acceptation de sa décision. Elle vise clairement à obtenir que sa décision soit reconnue comme légitime. Le lundi après-midi, la classe se rend à la rencontre sportive. Au moment du relais près de la ligne de départ, Francine sort une feuille et nomme les élèves qui vont y participer. La classe l’écoute. Elle ne perçoit aucune surprise.
Analysons maintenant ce qui s’est passé dans cet épisode. Les réactions des élèves confirment l’expertise des observations de l’enseignante et la justesse de son interprétation de leurs intentions, véritables guides pour son action. L’efficacité du différé associé au déploiement d’une communication efficace est également à souligner. Si l’ordre a été perturbé dans sa classe, Francine a pris son temps pour réfléchir et réagir. Elle a sanctionné les élèves perturbateurs, mais la sanction n’a pas été immédiate. Pour être comprise, elle est passée par l’énoncé d’une règle valable pour tous. Enfin, Francine n’a pas pris à partie directement les élèves, mais ils ont pourtant bien compris le message : la règle n’a pas été respectée, une sanction s’applique. Ainsi, elle n’a pas fait du comportement des trois élèves perturbateurs un problème lié à sa personne, mais a situé l’enjeu de la situation au niveau des valeurs qu’elle cherchait à transmettre.
Ce faisant, elle a mis en œuvre quelques principes caractéristiques de l’autorité éducative. À savoir : énoncer une règle indiscutable et donc légitime ; sanctionner des actes et non des personnes ; ne pas humilier les élèves.
Passons maintenant au second exemple. Alain est professeur de mathématiques et débute dans ce collège. Début septembre, cinq élèves de troisième technologique entrent en cours coiffés d’une casquette, passent devant lui en lui tournant le dos, s’assoient au fond de la classe, le regardent, se balancent sur leurs chaises…
Le professeur ressent cette entrée comme une provocation. Il va fermer la porte de la salle, sans savoir quoi faire. Il se dit d’abord qu’il peut débuter le cours de façon habituelle, permettre aux transgresseurs de se calmer et ne pas chercher l’affrontement. De retour au bureau, Alain demande à tous de sortir leurs affaires, tout en sachant qu’une majorité l’a déjà fait, mais pas les récalcitrants. La situation semble bloquée. Alain se lève et rappelle aux trois élèves l’interdiction des casquettes en classe, de se balancer sur la chaise et réitère sa demande de sortir leur matériel. Aucune réaction. Il s’interroge sur l’opportunité de l’exclusion, solution qui lui paraît mauvaise pour installer son autorité. De plus, il n’est pas certain de sortir vainqueur du rapport physique : « La seule solution est de les garder en cours. » Il se déplace alors lentement vers le fond de la classe. Puis il explique aux cinq élèves qu’il a bien perçu leurs comportements comme une provocation dirigée contre lui, mais qu’il veut leur donner la possibilité de changer d’attitude et de se comporter comme les autres. Ces propos provoquent des discussions entre les cinq élèves. Alain reprend la parole. L’un des cinq décide alors d’enlever sa casquette et la pose sur son sac. Un autre, Willy, demande : « Et si on l’enlève pas, vous faites quoi ? » Alain parle tranquillement. Il s’adresse aux élèves sur le mode de la fausse alternative : soit ils obéissent en enlevant leur casquette et en la lui donnant ; soit ils refusent d’obéir en risquant à terme l’exclusion du collège, mais Alain ne les exclura pas du cours. Ainsi, le professeur cherche à faire mesurer à chacun les graves conséquences pour lui de l’infraction mineure commise. Il se déplace ensuite vers son bureau, puis commence son cours. Quelques instants plus tard, il observe que trois élèves ont enlevé leur casquette et l’ont posée sur leur sac. Seul Willy résiste. Alain le questionne d’une façon agressive sur ce qu’il compte faire. Willy le regarde et lui adresse un refus net : « Moi je l’enlèverai pas. » Puis il se lève, bouscule sa chaise avec colère. Cependant, Alain remarque sa position rentrante des épaules, comme soumise. Il se rapproche alors progressivement, parvient à clore la discussion en haussant le ton, et en se tenant bien droit. Il s’adresse alors à Willy sur le mode de la fausse alternative : soit il décide seul de quitter la salle et par là même risque de se faire exclure du collège, soit il décide d’obéir. Un « moment de blanc » suit. Le regard de Willy décroche, sa tête se balance, il regarde ses camarades. Le professeur interprète ces informations comme une opportunité. Il avance, pousse physiquement l’élève vers la porte qu’il ouvre. Puis il se retourne et dit « maintenant, tu décides », en montrant l’une de ses mains ouverte vers la chaise, et l’autre tenant la poignée de la porte. Willy s’assoit et donne sa casquette au professeur, qui ferme la porte. De son bureau, Alain dit à Willy : « Je crois que tu as choisi la solution la plus intelligente, donc y’aura pas de sanction. »
Après analyse, quelques caractéristiques d’une relation d’autorité éducative apparaissent bien dans cet épisode critique. Alain a fait appel à plusieurs procédés. D’abord, remarquons qu’il a refusé la sanction immédiate (l’exclusion de classe) et l’affrontement physique. Il s’est donné pour buts de rester dans une relation d’autorité – donc de ne pas recourir à la violence physique – et de maintenir le lien avec les élèves. Ainsi, il a engagé un dialogue en leur proposant de faire un choix : revenir à un comportement d’élève et rester parmi les autres. Face à Willy, l’élève récalcitrant, il le pousse dans ses retranchements, mais en lui donnant la possibilité de décider lui-même de l’issue : l’obéissance aux règles commune ou l’autoexclusion. Ce choix peut apparaître comme une fausse alternative et relever de la manipulation, mais on peut aussi voir les choses sous un autre angle : Alain fait appel à la raison et à la capacité de décision de l’élève. Quand celui-ci décide finalement d’accepter la règle, Alain lui adresse une parole de reconnaissance (« tu as pris une décision intelligente »), qui le replace en position de sujet. Tout ne s’est pourtant pas passé courtoisement. Alain a su, à un moment donné, pousser l’élève vers la sortie en restant ferme quant au choix qui s’offrait à lui, adopter une posture surplombante, hausser ou baisser la voix sans perdre le contrôle… Cependant, il ne s’est pas acharné sur Willy dès lors qu’il avait atteint son but. Ce sont là autant de savoirs d’action qui participent de son autorité.
Essayons maintenant de tirer quelques enseignements généraux de ces exemples et d’approfondir la réflexion sur la notion d’autorité.
Trop souvent encore, le sens commun confond l’autorité avec le pouvoir d’un recours possible à la force, alors que l’autorité véritable est justement une influence qui s’exerce sans la force (4). L’autorité n’est donc pas l’autoritarisme, relation où le détenteur d’une position statutaire exerce une domination sur l’autre afin d’obtenir de lui une obéissance inconditionnelle, sous la forme d’une soumission.
L’autorité ne peut être réduite non plus à cette qualité personnelle mystérieuse que l’on appelle le charisme et qui ferait que l’enseignant ne devrait compter que sur sa personne. L’autorité « charismatique », qui use en fait de la séduction au lieu de la force, vise au final à soumettre l’autre, à le garder dépendant et non à l’aider à acquérir son autonomie.
Enfin, il existe actuellement dans la relation éducative une tendance à refuser l’idée d’autorité au motif qu’elle est illégitime et antiéducative. Ce déni d’autorité se manifeste par le refus d’intervenir de certains professeurs lors d’incidents entre élèves, l’évitement de la mise en situation d’apprentissage s’il y a conflit, l’exclusion de classe ou d’établissement au prétexte que l’autorité professorale n’est pas acquise d’emblée, que l’élève réel n’est pas l’élève attendu. D’une manière générale, cette conception n’est pas sans risques pour l’enfant ou l’adolescent considéré comme prématurément responsable de ses actes.
L’enjeu de l’exercice d’une autorité éducative consiste justement à maintenir quoiqu’il arrive la relation d’éducation, sans céder à l’autoritarisme, à la séduction charismatique ni « évacuer » l’autorité en laissant le jeune se chercher seul ses propres limites. Il en va, en un sens, de l’avenir de la fonction d’éducation dans nos sociétés.
http://www.scienceshumaines.com/s-imposer-en-classe-peut-il-s-apprendre_fr_29784.html

|
Tous, nous ressentons des émotions, et comme vous devez le savoir, toutes n’ont pas les mêmes valeurs ni les mêmes effets. Quand vous vous levez de bonne humeur le matin, en débordant d’optimisme, de joie et d’énergie, vous sentez bien que ces émotions sont positives, elles vous rendent heureux et productif. En revanche, quand dés le matin vous vous sentez fatigué, las, démoralisé, irritable, vos chances de passer une bonne journée sont bien minces. Ainsi, certaines émotions sont plutôt positives, d’autres sont plutôt négatives. Nous avons chacun notre caractère, qui nous fait globalement pencher d’un côté ou de l’autre de la balance. Quand certains sont généralement optimistes et joyeux, d’autres sont acariâtres et aigris. D’autres, encore, oscillent en équilibre. Nous connaissons également des variations minimes d’un jour à l’autre, et même les plus joyeux se sont un jour ou l’autre senti démoralisés, irrités ou énervés. Or, il se trouve que les émotions sont communicatives. Avez-vous remarqué comme certaines personnes parviennent à faire partager leur optimisme et leur gaité à leur entourage ? Face à quelqu’un de particulièrement ouvert, gentil, généreux et souriant, n’aurez vous pas le réflexe de sourire à votre tour ? En revanche, les personnes malpolies et sarcastiques sont pénibles, elles nous irritent et nous énervent. Les sentiments positifs appellent d’autres sentiments positifs. Les sentiments négatifs appellent d’autres sentiments négatifs. N’êtes vous jamais sorti de chez un commerçant particulièrement sympathique un peu plus heureux que lorsque vous y êtes rentré ? Et n’êtes vous jamais sorti de chez un autre marchand aigri et méchant d’un peu moins bonne humeur que vous n’y avez pénétré ? ;;;;;• Les émotions sont communicatives Tout ceci implique une conséquence trés grave. Cela signifie que les émotions que vous exprimez ont une influence directe sur votre environnement. Le monde peut être vu comme une immense balance contenant sur ses plateaux de gigantesques réserves de forces positives et négatives s’équilibrant à peu près. Et vous avez la possibilité, à tout moment, d’appuyer du doigt sur l’un ou l’autre des plateaux. Ainsi, lorsque vous exprimez un sentiment positif, par exemple en complimentant quelqu’un, en montrant de la gentillesse, de la générosité ou de la gratitude, vous instillez un peu de positif dans votre environnement. A l’inverse, si vous faites preuve de méchanceté, d’égoïsme ou de mesquinerie, ou que sais-je encore, vous continuerez à rendre votre monde pire qu’il n’est. Ceci est vrai à différentes échelles. Par exemple, le repas du soir en famille pourra être un agréable moment si vous vous montrez enjoué et distrayant, mais vous pourriez aussi bien vous montrer froid et cassant et ainsi pourrir l’ambiance. Plus globalement, chaque supporter peut contribuer à changer un match de foot en catch. Bien évidemment, plus l’échelle considérée est grande, et moins l’individu isolé détient de pouvoir.
|
Qui sont les enseignants qui ont les meilleurs résultats et marquent des générations d'élèves? Depuis quelques années, les chercheurs en psychologie décryptent leurs qualités.
Faites le test: demandez à une tablée «Vous vous souvenez de vos profs?» et vous ne pourrez plus venir à bout des confidences. Car, tous, nous avons été marqués par ces adultes qui, juste après nos parents, avaient la mission essentielle de nous aider à comprendre le monde. Marqués, certes, mais en bien… comme en mal.
Alain Golomb, aujourd'hui 50 ans et lui-même devenu professeur de lettres, auteur d'une série de textes caustiques et ciselés sur sa profession (Profs et Cie, Éd. Arlea), n'oubliera jamais son maître d'éducation physique à l'école élémentaire. «Je n'avais pratiqué aucun sport jusqu'à l'âge de 9 ans. D'emblée, j'étais nul. Et lui ne cessait de se moquer de moi: “Ah, tu réussiras à monter à la corde… Dans dix ans!”, me lançait-il devant les autres élèves pendant que j'essayais de grimper. J'entends encore mes camarades rire à gorge déployée.»
«Le mauvais prof est celui qui humilie»
De cette triste expérience, Alain Golomb a gardé une certitude qui l'aide dans l'exercice de son métier: «Le mauvais prof est celui qui humilie.»
Ce sont d'autres rencontres, plus tard, qui l'ont non seulement réconcilié avec l'exercice physique, mais ont aussi éveillé sa vocation. «Des profs de lettres qui récitaient des poèmes en plein cours, connaissaient de tête de nombreuses citations, toujours dites à propos, et nous laissaient sans voix à notre pupitre, étonnés par tant de virtuosité.» Pour lui, ceux-là étaient «des bons, car ils faisaient corps avec leur savoir».
C'est en effet la première et indispensable qualité des enseignants captivant leurs classes: l'enthousiasme. Christopher Day, professeur émérite en éducation à l'université de Nottingham, a mené de 2006 à 2008 une étude qui incluait 300 enseignants et pas moins de 3000 élèves. Il a ainsi découvert que les enseignants les plus efficaces auprès des élèves représentaient une catégorie à part: ceux-ci n'avaient pas plus d'expérience que leurs confrères, mais un fort enthousiasme pour leur travail, une puissante motivation, un réel engagement. «Ils créent un climat propice à l'apprentissage en discutant les idées des élèves, en les inspirant, en se montrant innovants dans leur exercice», décrit Christopher Day.
Plus récemment, le chercheur Robert Vallerand, du Laboratoire de recherche sur le comportement social de l'université du Québec, à Montréal, a démontré que les professeurs passionnés et surtout ceux qui le sont de façon harmonieuse (et non de manière obsessionnelle) sont ceux qui savent mieux transmettre leur passion pour la matière qu'ils enseignent.
Un constat fait aussi par Alain Golomb: «En lettres, c'est certain, les meilleurs profs sont ceux qui continuent à lire, qui écrivent… Dans certaines matières, comme l'histoire ou les langues vivantes, il est essentiel de sans cesse mettre à jour ses connaissances. En maths, il est évidemment plus difficile de conserver un rapport vivant avec sa discipline, concède le professeur. Et après trente ans de métier, c'est une vraie gageure de garder intense sa passion.»
C'est alors qu'une autre qualité chez l'enseignant peut s'avérer déterminante: la confiance dans les capacités des élèves. Ainsi, une célèbre expérience a démontré «l'effet Pygmalion»: lorsque des enseignants croient à des progrès probables chez certains élèves, ceux-ci obtiennent effectivement de meilleurs résultats.
Encourager les élèves à construire leur liberté
Pour Alain Golomb, cette qualité de l'interaction prof-élève renvoie aussi à la mission d'«éveilleur» conscientisée chez les enseignants compétents: «Ceux-là secouent les élèves, les déstabilisent…» On pense alors au professeur Keating, personnage décapant interprété par Robin Williams dans le film Le Cercle des poètes disparus: refusant tout conformisme, il encourageait chaque élève à construire une vraie liberté.
Toutes ces qualités humaines ne seraient évidemment rien sans l'art d'enseigner indispensable à tout pédagogue. «On apprend à enseigner en faisant des stages, des formations, en assistant aux cours de grands professeurs», relate Alain Golomb, soulignant que la réinvention d'écoles nouvelles du professorat ou des IUFM «est absolument indispensable». Car la transmission vivante des connaissances se nourrit à la fois de talent et de technique. «Rien à craindre donc des nouvelles technologies qui, certes, offrent une masse inégalable d'informations et de documentation aux élèves, estime le professeur. Même si elles existent, l'élève aura toujours besoin d'enseignants en chair et en os, des êtres humains qui offrent un moment de leur vie.»
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/09/04/18977-ces-profs-qui-ont-change-nos-vies
Ces dernières années, les écoles maghrébines sont devenues des scènes de fréquentes attaques par les élèves contre leurs enseignants. Ce phénomène a incité les responsables dans le domaine de l’éducation à tirer l’alarme non seulement concernant la baisse de la qualité d’enseignement, mais aussi au sujet des conséquences désastreuses de la violence sur les sociétés maghrébines. Toutefois, la question qui se pose à ce niveau est la suivante : Quels sont les facteurs qui ont mené à la détérioration de la relation enseignant-élève ? Et quels sont les moyens susceptibles de mettre fin à la violence des élèves contre leurs enseignants ?
Diverses études et statistiques indiquent que le phénomène des agressions contre les enseignants dans les sociétés maghrébines a pris des proportions plus dangereuses au cours des dernières années. En fait, les récents changements qui ont eu lieu dans le Maghreb, ont fait des enseignants un maillon faible dans le système social. Nous devons d’abord considérer ce qui se passe dans les foyers. La violence à l’école est le résultat de la violence à la maison, qui pousse à son tour les enfants à exprimer leurs émotions réprimées à travers des comportements agressifs pouvant affecter les enseignants à l’école.
Mettre la faute sur les familles est objectivement justifiable. Cependant, la situation sociale inconfortable des sociétés maghrébines, et l’incapacité de plusieurs familles à satisfaire les besoins matériels et immatériels de leurs enfants, sont des facteurs qui ont incité les parents à chercher à améliorer leurs revenus. Cela a résulté, dans de nombreux cas, à l’incapacité des parents à surveiller leurs enfants qui tombent, par conséquent, victimes des réseaux de violence.
Le système éducatif a sa part de responsabilité concernant le nombre croissant des cas de violence contre les enseignants. En fait, les enseignants eux même contribuent à un certain degré à la propagation de ce phénomène. Des études psychologiques démontrent que l’encadrement des élèves qui ont tendance à être violents peut réduire la gravité des attaques. En outre, les punitions continues des enseignants contre les élèves peuvent provoquer des réactions agressives de la part de ces derniers.
La société a aussi sa part de responsabilité, vu que les enfants sont souvent victimes de ses agitations, en particulier avec l’émergence de certaines idées extrémistes qui appellent à la violence, et la propagation de ces idées parmi les jeunes, particulièrement les adolescents.
Etant donné la multitude des causes qui ont conduit à la propagation de ce phénomène, trouver une solution requiert un processus de réforme compréhensive. Cette réforme ne doit pas être un fardeau sur les épaules des enseignants uniquement, car il faudra aussi veiller à garantir une vie décente aux citoyens. Cette solution comprend les mesures suivantes: stimuler la vie économique avec des projets générateurs de richesses, tenir compte des aspects éthiques et éducatifs, et fournir les conditions nécessaires pour que les écoles visent à créer de la richesse scientifique, par des moyens de réalisation et d’éducation basés sur des méthodes modernes de formation à la fois des étudiants et des enseignants. Tout cela vise à créer des perspectives pour les individus et les familles, pour que la violence devienne le dernier recours pour tout le monde.
http://zawaya.magharebia.com/fr/zawaya/opinion/242
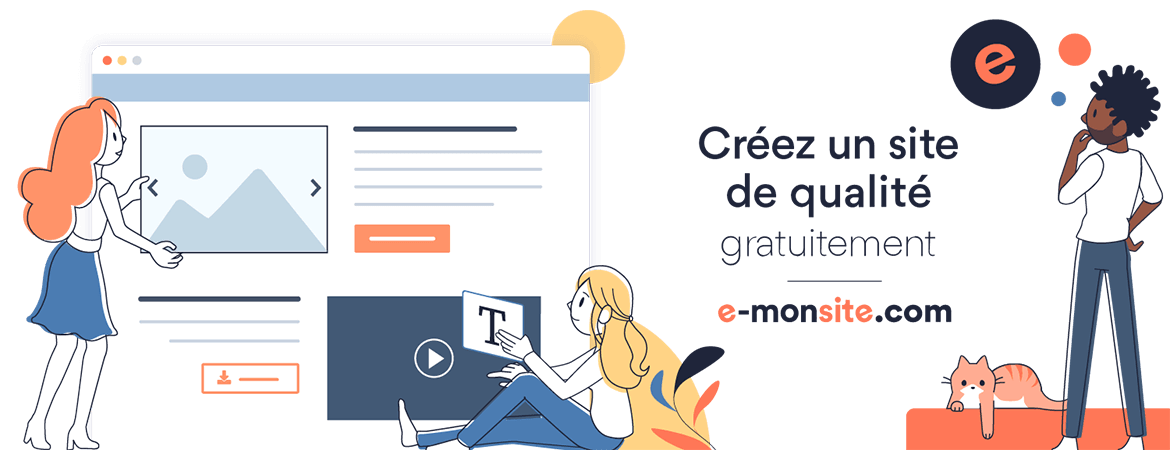



1. Par Mehdi El le 2025-04-10
Bon travail Merci
2. Par wassim le 2024-02-26
tres bien
3. Par fistone le 2023-07-09
Bon courage
4. Par mouna el achgar le 2023-07-09
je suis une enseignante de la langue française et cette année je vais enseigner pour la première fois ...
5. Par Salwa le 2023-03-18
Merci
6. Par Rbandez le 2022-11-19
Trés Bon resumé
7. Par Rbandez le 2022-11-19
Trés Bon resumé
8. Par El otmani le 2022-11-01
Bonjour Merci pour votre exemple je le trouve vraiment intéressant Auriez-vous un exemple pour une ...