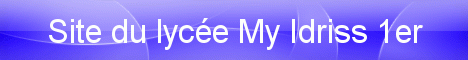 referencement sur bing - référencement de site web gratuit -
referencement sur bing - référencement de site web gratuit -

"Quand j’étais petit, je croyais naïvement que pour réussir sa vie, il fallait bien travailler à l’école.
Après tout, la réussite scolaire mène aux meilleurs diplômes. Les meilleurs diplômes mènent aux meilleurs emplois. Les meilleurs emplois mènent aux meilleurs salaires. Et l’argent fait le bonheur ![]()
Puis j’ai cessé de croire au Père Noël, le choc !"

Il y a plus d’une bonne ou mauvaise raison de ne pas aller à l’école, mais depuis le milieu des années 2000, il en est une qui se développe: la « phobie scolaire ».
Au plus simple, c’est un comportement de refus angoissé de l’école chez l’adolescent. Selon une étude ancienne, les deux tiers des cas reconnus seraient précurseurs de troubles névrotiques, voire psychotiques chez l’adulte. Oui, mais voilà : psychiatres, médecins et pédagogues s’interrogent sur l’utilité d’une telle catégorie pathologique, car on ne sait pas trop à quelle cause l’attribuer.
Plusieurs thèses se partagent l’explication du phénomène. Une phobie suppose une causalité endogène. Dans le cas présent, ce serait une angoisse spécifique d’avoir à apprendre, ou d’être incapable de le faire. Selon d’autres psychiatres, ce serait la crainte d’être confronté à autrui, voire la conséquence d’un harcèlement. Les auteurs anglo-saxons parlent de « refus scolaire », qui a peu à voir avec l’école, mais serait une forme tardive de l’angoisse d’être séparé de ses proches. À l’opposé, la cause peut être cherchée dans l’inadaptation du système scolaire, soit qu’on le juge anxiogène par nature, soit qu’on incrimine un moment de crise dans la transmission de la culture. Dans ce cas, on parle de « décrochage scolaire » et non de phobie.
Comme le souligne Philippe Mazereau, chercheur à l’université de Caen, le choix des mots est donc un problème. Celui des remèdes en est un autre. Or, son enquête montre deux choses. D’abord, il existe une demande croissante de diagnostic « phobique » de la part des parents, plus que des médecins. Ensuite, s’il n’existe pas de description consensuelle de la phobie scolaire, le diagnostic est déductible du traitement que l’on applique : s’il y a prise en charge psychologique et scolarisation à la maison, alors c’est bien une phobie scolaire, et non un autre trouble, qu’il soit de séparation ou lié à la « crise adolescente ».
Philippe Mazereau et al. (coord.),
« Phobie scolaire ou peur d’apprendre ? »,
La Nouvelle Revue de l’adaptation
et de la scolarisation, n° 62, juillet 2013.

Participer en classe représente une véritable épreuve et crée pour un grand nombre d’élèves un sentiment de mal-être. Cela peut dans la majorité des cas nuire à leur apprentissage. En effet, beaucoup d’élèves aux collèges et lycées n’arrivent pas à participer en classe pour plusieurs raisons : peur de la réaction des camarades, timidité, manque de confiance en soi…
Tu as souvent peur de la réaction des autres lorsque tu lèves la main? Tu as du mal à prendre la parole en classe même si tu comprends bien la leçon? Tu n’as pas compris la leçon et as peur de poser la question?
Suis donc ces 6 simples conseils qui t’aideront à participer plus en classe !
Une bonne façon de participer en classe est de poser des questions. Pour participer en classe, il ne s’agit pas seulement de répondre aux questions du professeur, tu peux donner ton opinion par exemple ou tout simplement poser des questions.
Lorsque tu as une question à propos de quelque chose que tu n’as pas compris ou que tu as envie de savoir plus sur un sujet, lève la main et pose ta question.
Sache qu’un élève qui ne pose pas de question quand il comprend pas a forcément tendance à régresser.
L’une des meilleures façons qui t’aideront à oser participer en classe est le fait de s’entraîner chez soi. Tu vas faire peut être beaucoup d’erreurs mais l’avantage c’est que tu es seul dans cette étape. Profites de cet exercice pour te corriger et apprend de tes erreurs pour ne pas les commettre en classe.
Si tu n’as pas l’habitude de participer en classe, il faut apprendre petit à petit. Commence à communiquer plus avec tes amis et ta famille. Tu peux par exemple leur raconter ce que tu as fait pendant la journée ou ce que tu as appris en classe. Tu peux aussi donner ton avis sur un film, une chanson, un livre ou tout simplement raconter tes sorties ou tes vacances… Tu verras, cette technique t’apprendra à mieux communiquer avec ton entourage et t’encouragera à participer en classe.
Souvent, beaucoup d’élèves ne participent pas parce qu’ils n’ont tout simplement pas révisé leurs cours avant de venir en classe. Pour avoir le courage de participer en classe, il est préférable de réviser le cours précédent au moins une fois avant de venir en cours. Les révisions t’apporteront beaucoup par la suite et t’encourageront à devenir plus dynamique et motivé en classe.
Il existe beaucoup d’activités parascolaires efficaces pour développer l’aisance à l’oral, d’avoir plus confiance en soi. Il est donc très conseillé de te lancer dans une activité de loisirs en dehors du collège ou lycée comme par exemple : cours de musique, cours de théâtre, cours de dessin, cours de danse ou encore la participation aux sports collectifs.
Il s’agit en effet d’excellents moyens de devenir une personne confiante car ce sont des activités qui permettent de s’exprimer d’une manière différente.
Tu verras, qu’avec le temps, tu participeras plus en classe, quel que soit le regard ou les remarques de tes camarades sur toi.
Si tu es en classe c’est pour apprendre! Ne te fais pas alors de soucis lorsque tu commets une erreur. Si tu n’arrives toujours pas à participer en classe pour une raison ou pour une autre, tu peux le dire à ton professeur. Il est le mieux placé pour t’aider à surmonter cette difficulté. En lui parlant, il saura que tu es motivé et t’encouragera progressivement à prendre la parole en classe.
http://www.9rayti.com/conseil/conseils-participation-classe

L’apathie caractérise l’état d’une personne qui n’éprouve aucune motivation, aucun intérêt, aucune passion. Jadis employée pour qualifier l’attitude des soldats au retour de la Première Guerre mondiale, ces derniers ayant perdu l’intérêt pour la vie civile, l’apathie se manifeste en cas de dépression, de schizophrénie ou de problèmes neuronaux comme l’hypothyroïdie (insuffisance hormonale de la thyroïde).
Prendre des décisions, accomplir des actes pourtant planifiés devient difficile pour ceux qui sont atteints d’aboulie. Une personnalité aboulique a la volonté d’accomplir des actions, mais elle est dans l’incapacité physique de le faire. Ce trouble peut provenir de maladies comme la narcolepsie, la fatigue chronique ou encore le syndrome d’épuisement professionnel (burn-out).
Les chercheurs ont identifié depuis longtemps le rôle de ce neurotransmetteur : la libération massive de la dopamine après un effort permettrait de comprendre la motivation à court terme. Mais comment expliquer les projets de longue haleine, récompensés plusieurs mois, voire plusieurs années après leur lancement (régime, projet professionnel ou familial) ? Une étude réalisée par des biologistes américains montre que la dopamine est présente dans le corps tout au long d’un effort, en moindre quantité cependant. On anticiperait la récompense à venir en libérant un peu de substance, ce qui permet d’entretenir la motivation. Du moins, c’est ce que révèle l’expérience de Mark W. Howe et de ses collègues, réalisée sur des rats.
Une fatigue ponctuelle peut entraver la capacité à rester concentré et faire perdre toute motivation. Mais la fatigue peut être plus qu’un état temporaire. Les personnes atteintes du syndrome de fatigue chronique (SFC) éprouvent une sensation d’épuisement qui ne disparaît pas, malgré le repos. Elles doivent réduire leurs activités à cause de troubles de la mémoire, de malaises physiques ou encore de douleurs musculaires et articulaires. Confondue pendant longtemps avec la dépression, la fatigue chronique provoque un état d’abattement et une perte de motivation d’autant plus forte qu’elle est peu reconnue socialement. Pour la traiter, certains prônent la thérapie comportementale, tandis que d’autres, comme les associations, préconisent d’adapter son mode de vie à l’état de fatigue ressenti.
La « fatigue d’être soi » : le sociologue Alain Ehrenberg qualifie ainsi la dépression. Elle se caractérise par un changement durable d’humeur (plus d’une quinzaine de jours) provoquant une perte de motivation, une grande lassitude, un manque d’envie généralisé. La dépression ne doit pas être confondue avec la déprime, passagère. Les facteurs psychologiques, comme une perte de confiance en soi, côtoient les interprétations biologiques (perturbation des neurotransmetteurs) et les causes sociales, pour comprendre cette maladie qui touche tout de même près d’un Français sur cinq au cours de sa vie ! Selon A. Ehrenberg, la dépression résulte de la concurrence exacerbée entre les individus. Notre société inciterait à être toujours plus performant au travail, à l’école, en famille, et même dans les loisirs. Chacun d’entre nous devrait sans cesse affirmer sa personnalité à travers ses activités, de manière à montrer le meilleur de soi. La dépression résulterait de cet excès de responsabilité.
L’hyperactivité est une « pathologie de la motivation », selon le neurologue Michel Habib. Découvert dans les années 1990, ce que l’on nomme dans le milieu médical « trouble de l’attention, avec ou sans hyperactivité » (TDAH) concerne environ 5 % de la population. Il se manifeste par une agitation motrice, des difficultés à rester concentré sur une tâche ou encore la perception de stimuli perturbateurs et le besoin d’y répondre, ce qui génère une dispersion quasi permanente. Le trouble concerne plus souvent les garçons (9 %) que les filles (3 %). Dans une classe de niveau primaire, on estime qu’au moins un enfant est atteint. L’avancée en âge ne suffit pas toujours à soigner : les enfants hyperactifs peuvent le rester à l’âge adulte.
« Le TDAH ne devrait plus être considéré comme un défaut des systèmes d’inhibition, mais comme un débordement de ces derniers, par une activité excessive et anarchique, provenant des systèmes de récompense », explique M. Habib. L’enfant ou l’adulte TDAH s’emballe rapidement, stimulé par la libération de dopamine. Il produit une activité riche et effervescente, mais désordonnée, par excès de motivation. Si l’on sait diagnostiquer ce trouble grâce à des questionnaires administrés par des neuropsychologues, le traitement fait encore débat : faut-il prescrire des substances médicamenteuses ou privilégier la rééducation ? Un peu des deux certainement…
• La Fatigue d’être soi.
Dépression et société
Alain Ehrenberg, Odile Jacob, 1998.
• « Apathie, aboulie, athymhormie : vers une neurologie de la motivation humaine »
Michel Habib, Revue de neuropsychologie, vol. VIII, n° 4, 1998.
• « Le cerveau de l’hyperactif : entre cognition et comportement »
Michel Habib, Développements, n° 9, 2011/3.
• « Prolonged dopamine signalling
in striatum signals proximity and value of distant rewards »
Mark W. Howe et al., Nature, vol. D, n° 7464, 29 août 2013.
• « La dépression. En savoir plus pour en sortir »Inpes, 2007.
www.tdah-adulte.org
www.asso-sfc.org
http://www.scienceshumaines.com/les-troubles-de-la-motivation_fr_33999.html
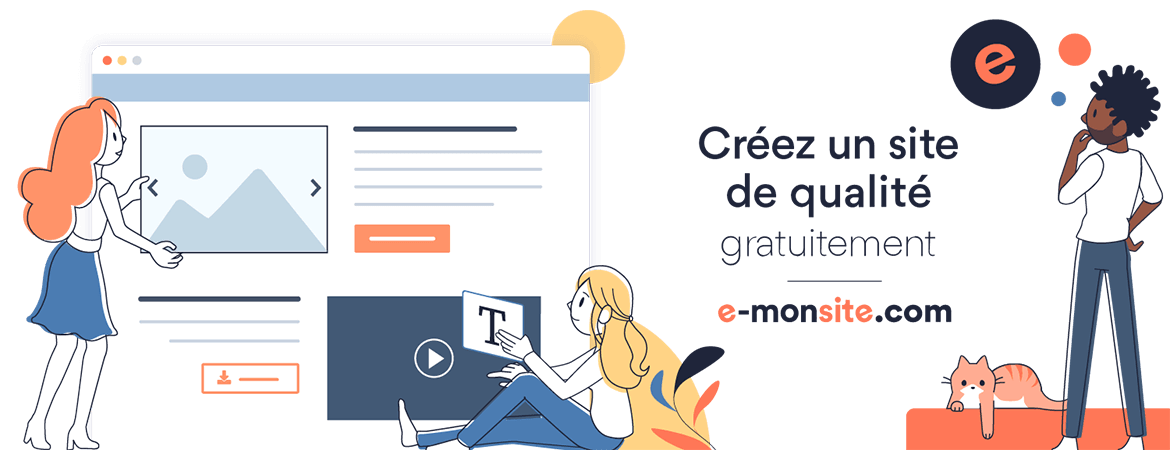
1. Par Mehdi El le 2025-04-10
Bon travail Merci
2. Par wassim le 2024-02-26
tres bien
3. Par fistone le 2023-07-09
Bon courage
4. Par mouna el achgar le 2023-07-09
je suis une enseignante de la langue française et cette année je vais enseigner pour la première fois ...
5. Par Salwa le 2023-03-18
Merci
6. Par Rbandez le 2022-11-19
Trés Bon resumé
7. Par Rbandez le 2022-11-19
Trés Bon resumé
8. Par El otmani le 2022-11-01
Bonjour Merci pour votre exemple je le trouve vraiment intéressant Auriez-vous un exemple pour une ...