La journée nationale du sourire - Fais moi sourire!
Afin de vous aider à sourire davantage en classe, je vous propose près d'une vingtaine d'idées d'activités à réaliser en classe, que ce soit en français, en arts, en mathématiques ou même en sciences. J'ai aussi déniché à votre intention quelques sites Web pour créer, se divertir, apprendre, discuter ou même relaxer, toujours sur le thème du sourire.

20 façons de sourire à l'école
1- Composez une chanson thème sur le sourire. Toute l'école pourra la chanter en souriant. Les enseignants pourraient composer le refrain, et chaque classe pourrait créer un couplet différent.
2- Rédigez de petits messages qui incitent à sourire, un peu comme les messages contenus dans les biscuits chinois. Mettez-les dans une petite boîte à laquelle vous pourrez donner un nom particulier (La boîte à sourires, par exemple). Finalement, distribuez vos petits messages dans divers lieux ou même dans la rue, en faisant piger les gens.
3- Organisez de la publicité pour la journée : affiches, messages à la radio communautaire, macarons... L'objectif: inciter les gens à sourire et à vivre en harmonie.
4- Créez des cartes de souhaits pour la journée. Faites ainsi parvenir des sourires à vos proches ou aux élèves des autres classes.
5- Faites aller votre plume sur le thème du sourire : histoires, poèmes, chansons, journal du sourire, recherches sur les effets du sourire ou même sur l'humour ou le bonheur... Créez un recueil ou publiez vos textes sur le Web.
6- Participez à un sourire-o-thon. Il suffit de sourire le plus longtemps possible. Qui tiendra le coup pour la plus longue période? Quel est l'effet ressenti à force de tant sourire?
7- Invitez un clown en classe ou déguisez-vous (ou les élèves) en clown. Vous pourrez créer des costumes avec des retailles de tissus et des nez cirés rouge (un demi-emballage ciré de fromage Mini Babybel fait le travail et fournira en plus une dose de protéines à vos élèves. Collation rigolote et succulente!). Avec du carton, vous pourrez confectionner un chapeau de clown et une boucle pour le cou que les enfants décoreront avec des crayons, de la peinture ou d'autres éléments.
8- Participez à la quête des plus beaux sourires. Les élèves apportent des photos ou images de beaux sourires : ce peut être des photos de leur album personnel, des images trouvées dans les revues ou sur les publicités, etc. Ces images sont ensuite affichées sur les murs ou encore, utilisées pour concevoir un scrapbook de classe sur le thème du sourire.
9- Créez, personnellement ou en groupe, un petit logo du sourire. Ce petit logo pourra ensuite être collé sur les bureaux de chacun afin de rappeler de sourire. Chaque élève pourra évidemment agrémenter son logo à sa façon.
10- Participez au jeu des sourires. Chaque élève apporte trois épingles à linge de la maison (identifiées au nom de l'élève, si vous souhaitez redistribuez les épingles à la fin de la journée). Chaque fois qu'un élève est surpris à ne pas être en harmonie avec les autres ou à être de mauvais poil, il doit donner son épingle à celui qui l'a pris en défaut. Voilà une excellente façon de passer une journée sans chicane et sans violence en classe. Qui réussira à conserver toute ses épingles?

11- Planifiez une séance de gymnastique du sourire, en début de matinée. Il suffit de passer une minute à faire de grands sourires, des sourires idiots, des sourires bizarres, brefs, toutes sortes de sourires et d'étirements de la bouche.
12- Organisez un concours de définition du mot sourire. Vous pouvez illustrer la définition en utilisant les mots qu'elle contient pour tracer un bonhomme sourire. Voyez cet exemple.
13- Dessinez un sourire. Distribuez à tous les élèves de l'école une feuille blanche comprenant seulement la forme vide d'un visage. Les élèves devront ensuite ajouter un sourire et des détails à ce visage. N'hésitez pas à encourager le collage et le dessin comme techniques artistiques. Vous pourrez ensuite afficher tous ces sourires sur les casiers des élèves ou dans les couloirs de l'école. Vous pourriez aussi réaliser une énorme murale de sourires dans la bibliothèque ou au gymnase, en y collant tous les sourires des élèves.
14- Repensez le bonhomme sourire. Invitez les élèves à modifier le fameux bonhomme sourire jaune à l'aide de couleurs, de papiers, d'éléments 3D, de papier mâché, etc. Créez ensuite une exposition de bonhommes sourires et faites voter les élèves pour les bonhommes les plus originaux ou sympathiques, par niveau scolaire.
15- Animez un blogue du sourire : les élèves pourront venir y raconter ce qui les fait sourire, chaque jour. Pendant une semaine, vous pourriez avoir un sujet du jour que les élèves pourront commenter : 1) les gens qui me font sourire, 2) les activités qui me font sourire, 3) les objets qui me font sourire, 4) les événements qui me font sourire, 5) les blagues qui me font sourire, etc. Pour créer facilement un blog, vous pouvez utiliser Blogger. Sinon, utilisez le blogue du sourire, déjà prêt à accueillir tous vos commentaires et créé à cette intention pour vous.
16- Faites aller les méninges des jeunes en leur proposant de concevoir un personnage ou un visage dont le sourire peut être actionné par un mécanisme au choix.
17- Participez au décompte des sourires. Selon le niveau de vos élèves, choisissez un nombre. Vos élèves devront ensuite partir à la chasse aux sourires et noter le nom (ou la description, s'il s'agit d'étranger) de tous ceux qui leur ont souri pendant la journée ou la semaine, jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre désigné ou même plus. Combien de sourires auront reçu tous les élèves de la classe?
18- Organisez des joutes d'improvisation, pour rire et sourire. Élaborez des thèmes humoristiques.
19- Fabriquez des marionnettes qui ont le sourire, avec des matériaux de votre choix. Ensuite, placez les élèves en équipes pour que chacune crée un petit sketch sur le bonheur, l'harmonie ou la paix.
20- Faites la course à relais des sourires. Divisez les élèves en deux équipes, dont les membres seront placés à la file indienne. Au signal, le premier élève doit courir jusqu'à une ligne et revenir vers la ligne de départ. Lorsqu'il revient, il doit exécuter 10 sourires avant que son coéquipier puisse prendre le relais du sourire. La première équipe dont tous les membres ont effectué la course remporte la victoire, et les perdants doivent les féliciter avec le sourire...

Des sites Web pour rire et sourire
Des textes pour réfléchir et partager les sourires
Juste un sourire... / Chez Maya
Accompagné d'un charmant diaporama de bébés qui sourient, ce petit texte incite tout le monde à sourire et à répandre une épidémie de sourires.
Les effets d'un sourire / Chez Maya
Tout le monde est capable de sourire, même les plus déprimés. Ce texte vous invite à essayer, sans plus tarder.
Souriez au suivant / La petite douceur de la semaine
Vous pourrez aussi télécharger une relaxation dirige sur le sourire (8 minutes)
La révolution du sourire juste / La petite douceur de la semaine
Ce document PDF de 40 pages convient aux enseignants qui souhaitent réfléchir sur le sourire. Certains éléments pourront ensuite être présentés ou adaptés en classe, pour initier des discussions.

Pourquoi sourire? Quelques explications...
Rien ne bat un beau sourire / L'Association canadienne pour la santé mentale
Si vous cherchez de bonnes raisons de sourire, vous en trouverez ici sept. De quoi convaincre les plus grognons!
À quoi nous sert le sourire? / Psychologies.com*
Le sourire sert beaucoup plus qu'à simplement illustrer notre joie ou notre bien-être. Cet article vous aidera à découvrir d'autres utilités du sourire. Les élèves sauront-ils en nommer avant même de prendre connaissance de l'article?
Des citations sur le sourire
Randonneur.net
Une vingtaine de citations vous sont ici proposées.
Evene.fr
Evene répertorie 150 citations sur le sourire, dont 30 ont été sélectionnés pour composer le guide thématique sur le sourire.

La biologie du sourire
Les ordonnateurs du sourire / Les secrets du corps humain
Voyez ici les 17 muscles qui sont sollicités lors d'un sourire.
Des images artistiques de sourires
Musée du sourire*
Cet espace d'expression artistique invite les internautes « à découvrir les oeuvres d'artistes contemporains dédiées à la plus subtile des expressions humaines » : le sourire.


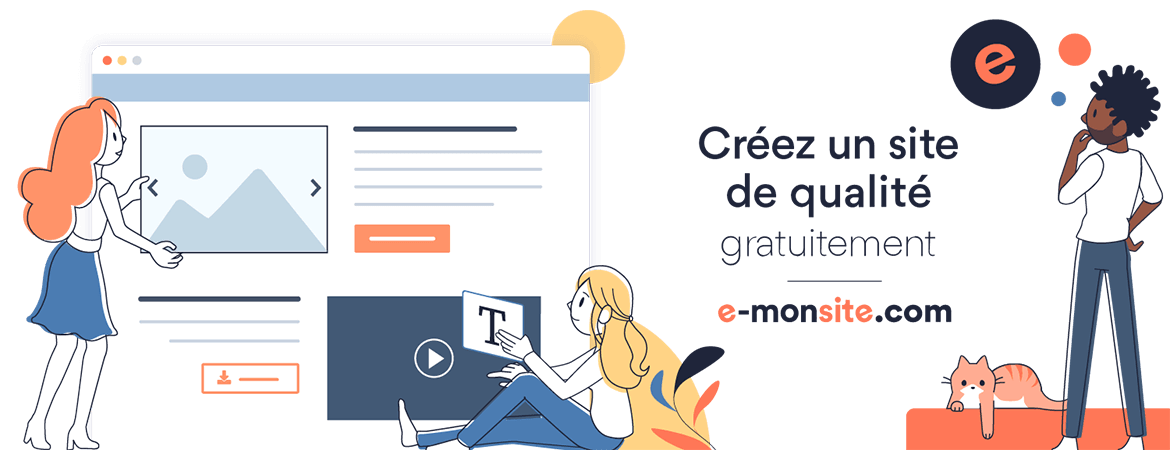

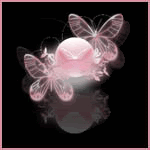









1. Par Mehdi El le 2025-04-10
Bon travail Merci
2. Par wassim le 2024-02-26
tres bien
3. Par fistone le 2023-07-09
Bon courage
4. Par mouna el achgar le 2023-07-09
je suis une enseignante de la langue française et cette année je vais enseigner pour la première fois ...
5. Par Salwa le 2023-03-18
Merci
6. Par Rbandez le 2022-11-19
Trés Bon resumé
7. Par Rbandez le 2022-11-19
Trés Bon resumé
8. Par El otmani le 2022-11-01
Bonjour Merci pour votre exemple je le trouve vraiment intéressant Auriez-vous un exemple pour une ...