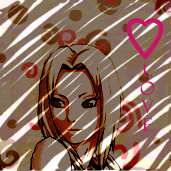
L’adolescence est un passage obligé entre l’enfance d’âge scolaire, période de latence avec socialisation communautaire, et l’âge adulte qui se definit en pratique comme le moment ou l’individu est reconnu adulte par la société dans laquelle il vit .
L’adolescent va avoir difficulté à s’identifier en tant qu’individu et à quitter un groupe où il a ses repaires pour en intégrer un autre aux codes différents.
On voit que la première définition de l’adolescence se réfère à la place de l’individu dans un système plus qu’à des critères d’âge ou de morphologie qui sont pourtant concomitants, et qui, susceptibles de variations individuelles, peuvent avancer ou retarder le moment de la problématique adolescente.
L’adolescence débute grosso modo avec la puberté qui étymologiquement signifie : époque où apparaissent les poils pubiens ; elle comporte des modifications morphologiques, impressionnantes aussi bien pour l’entourage que pour l’adolescent, et de fait celui-ci se trouve confronté à une double question :
1. Qui est ce nouvel individu pour moi ? (renvoyant ici essentiellement à la sphère psychique : L’adolescent ne se reconnaît plus) ;
2. qui est ce nouvel individu pour les autres ? (renvoyant là plus à la sphère organique et à l’organisation sociale, avec de plus la difficulté de se faire identifier dans deux groupes différents, celui de ses pairs (co-ados) et celui des adultes dont le regard est fondamentalement différent).
Cette double interrogation dont les réponses ne sont pas obligatoirement fournies simultanément, et pour lesquelles le décalage temporel peut être important, ne peut que créer un désordre, et chez certains une confusion entraînant des troubles variés allant de la plainte somatique à des troubles psychiques graves ou à des dysfonctionnements sociaux .
Vouloir ne considérer, comme cela est encore trop souvent le cas, les « crises d’adolescence » que comme des troubles « qui passeront » liés aux changements physiques, est sûrement aussi réducteur que de ne les considérer que comme des troubles psychiques à adresser aux psychiatres, ou encore comme des dommages collatéraux de l’organisation de la société adulte qui serait seule coupable .
Le problème le plus préoccupant est que, comme toute pathologie, les difficultés de l’adolescence peuvent laisser des séquelles graves si une prévention correcte n’est pas prescrite.
La triple composante organique, psychique et sociale demandera donc une approche multifocale.
Nous pouvons tous nous demander comment nous en avons réchappé (si tant est que ce soit le cas !...)
Nous allons d’abord faire le point, parce que c’est plus facile, sur le développement pubertaire « organique » que l’on pourrait dire « normal ».
1. Chez la fille en moyenne en l’an 2000 (puisque des variations sont notées au cours du temps avec une avance séculaire) la puberté débute à 11 ans avec (stades de Tanner) :
– petit bourgeon mammaire et élargissement de l’aréole (S2)
– quelque poils sur les grandes lèvres et le pubis (P2)
– à l’échographie pelvienne, un utérus qui commence à se développer avec une longueur > 40mm. la ligne endométriale apparaît. Les ovaires ont un volume >3 ml avec plusieurs follicules.
– L’accélération de la vitesse de croissance débutera avec une prise de taille annuelle qui va passer de 5 cm/an avant la puberté à 8 à 9 cm /an
– La radiographie du poignet permet de visualiser l’apparition du sesamoide du pouce qui correspond à un âge osseux de 11 ans et est le critère le plus commode du début de la puberté
Autour de 12 ans ce qui est le plus notable, c’est le pic de vitesse de croissance : 8 à 12 cm en un an, les premières leucorrhées, la pilosité axillaire, et à 13 ans (11-15) la ménarche suivie aussitôt du ralentissement de la croissance.
A 16 ans, l’aspect physique est adulte et la croissance n’est plus que de 1cm ou moins.
2. Chez le garçon, la puberté débute vers 12 ans avec le départ de l’augmentation du volume testiculaire : 4 à 6 mm (G2)
– suivi quelques mois après de quelques poils à la racine de la verge
– l’accélération de la vitesse de croissance débute
– vers 13 ans le pénis s’allonge. Une gynécomastie est souvent retrouvée, plus ou moins bien vécue, d’autant qu’elle est souvent associée à une séborrhée débutante et à de l’acné.
– le sésamoïde du pouce apparaît, ce qui permet à la radiographie du poignet de situer l’âge osseux à 13 ans et le vrai début de la puberté masculine
– La voix se modifie
– Enfin à 14 ans (donc nettement plus tardivement que chez la fille) se fait le pic de vitesse de croissance :10 a 15cm
A 16 ans la pilosité faciale apparaît et la voix devient adulte. Le cartilage thyroïde fait saillie.
Enfin a 18 ans la croissance staturale se finit avec un gain annuel de < 1cm.
Pendant ce temps, la masse musculaire est passée de 27% du poids corporel à 10 ans à 44 %, ce qui est moins marqué chez la fille avec une répartition du tissu adipeux sous-cutané différente.
Ces critères morphologiques peuvent déjà à eux seuls être des sources de difficultés pour l’adolescent, puisque aussi bien une puberté précoce (avant 9 ans chez la fille, avant 11 ans chez le garçon) qu’une puberté différée peuvent provoquer des interrogations de l’adolescent sur son statut réel : pour se situer (et être situé) dans le groupe, il va faire davantage appel à son morphotype et à son âge pubertaire qu’à son âge chronologique.
Les premières éjaculations vers le milieu de la puberté chez les uns, les premières règles chez les autres vont être plus ou moins l’objet d’interrogations sur le nouveau statut qui est en train de se mettre en place, avec la découverte d’un corps différent, parfois perçu comme étranger et donc souvent caché (voir les modes adolescentes tendant à dissimuler le corps derrière l’uniformisation), parfois rejeté jusqu’au pathologique
Le Pr. Patrick ALVIN, qui a été l’un des premiers pédiatres français à créer un service de médecine pour adolescents dans le service du Pr. Courtecuisse à Paris-Bicêtre, en soulignant qu’il ne faut pas découper l’adolescent en tranches et que l’approche multidisciplinaire est primordiale, s’est penché sur les différents stades de la puberté et a proposé une classification en 3 stades :
1- le début de l’adolescence : filles 11-13 ans, garçons 12-14, où apparaît vraiment la différenciation des sexes
2- la mi-adolescence : filles 13-16 ans, garçons 14-17, où se fait comme on vient de le voir le plus important de la transformation physique et où d’une part se fixe la sexualisation, et d’autre part se construisent les règles sociales.
3- la fin de l’adolescence : 17-21 ans, où se réalise une certaine indépendance avec la fin des transformations physiques, mais où le développement psychique et social n’est pas encore consolidé.
Sur le plan social maintenant, voyons quel est le statut de l’adolescent, puisque comme nous l’avons vu, le regard que jette la société sur le jeune définit en partie son statut
1- L’adolescent se heurte à la contradiction entre la revendication de sa reconnaissance par le milieu qui l’entoure et sa recherche éperdue d’une autonomie qu’il considère comme devant lui être due, alors même qu’il revendique l’assistance morale et matérielle de ce même milieu.
Les interdits jusque là plus ou moins acceptés (ou imposés) deviennent des contraintes inacceptables contre lesquelles, pour lui, la rébellion est légitime.
2- L’apprentissage occupe une grande partie de son temps, avec une scolarisation qui se situe entre le collège et le lycée, grosso modo de la 4ème à la terminale. Il faut remarquer que l’on demande un effort intellectuel important à un moment, la puberté, où la croissance staturo-pondérale est à son maximum, et donc tout se conjugue dans cette période de la vie pour désorienter un peu plus la « victime » de tous ces changements.
Il est donc inévitable que la période troublée traversée entre 12 ans et 18 ans, certains disent même 25 ans, ne puisse se dérouler sans anicroches. Si nous avons pour certains oublié nos problèmes d’adolescence, nous ne pouvons de toutes façons pas nous y référer : si certains points sont évidemment communs, l’environnement social n’a plus rien de comparable avec ce que nous avons pu connaître. Si la littérature de ce siècle, des Désarrois de l’élève Toërless de Musil à L’Attrape-cœurs de Salinger qui passionne encore la génération actuelle, peut rendre compte d’une certaine permanence de la psychopathologie de l’adolescence, il faut ré-envisager le problème dans son actualité socio-économique.
Le danger serait de méconnaître le nombre d’individus touchés et s’il est volontairement provoquant de dire que 99% des adolescents relèvent de la consultation psychiatrique, il n’en reste pas moins que les conséquences à long terme sont largement sous-estimées.
Voyons donc maintenant quelques définitions des troubles le plus souvent rencontrés et qu’il faudra essayer de dépister le plus précocement possible.
1- Les conduites à risques :
Ces conduites, qui traduisent à la fois le romantisme adolescent et l’angoisse profonde des métamorphoses subies, peuvent prendre des aspects variés.
- Chez l’adolescent qui trouvera son équilibre, cela se traduira par des exploits sportifs, une attirance pour les sports dits « de l’extrême », et permettra un épanouissement de la personnalité. Mais chez l’individu pour qui les mécanismes de protection endogène ou exogène ne joueront pas, la solitude et l’instinct de mort peuvent l’emporter : les accidents sont du coup importants dans cette tranche d’âge, soit avec les 2 roues soit, dès le permis passé, avec les 4 roues.
- L’agressivité vis-à-vis des autres peut aussi être classée dans ce cadre, avec chez l’adolescent une sous-estimation du préjudice causé à autrui.
- Les conduites sexuelles inadéquates avec bien souvent une négligence de l’autre et de soi, ce qui entraîne une absence de contraception chez la fille et une absence de protection chez le garçon. D’où le nombre en augmentation des grossesses non désirées à des âges de plus en plus jeunes.
La négligence du VIH et des autres maladies sexuellement transmissibles fait aussi partie des conduites à risques ; ne jouer que sur la peur pour développer la prévention n’est pas assez efficace
Toujours dans ces conduites :
- Les fugues, dans lesquelles nombre d’adolescents pensent trouver une liberté revendiquée. Mais, ayant rompu le lien économique et privés de la protection familiale, ils se trouvent entraînés dans des zones de vie à risque puisqu’ils deviennent des proies faciles.
2- Les suicides :
Ils peuvent traduire, soit le stade ultime des conduites à risque, soit le fond d’un repliement sur soi au terme d’une dépression parfois méconnue.
Le problème chez l’adolescent est double :
- d’une part, il ne faut pas négliger la dépression souvent présente chez l’adolescent, ce qui nécessite un dépistage très précoce devant :
-une fatigue d’agir
-une fatigue de sortir
-un refus d’avoir du plaisir
-un délitement de l’image de soi, trouble narcissique qui fait que l’adolescent ne se plaît plus.
- d’autre part, les troubles ne se traduisent pas toujours par un suicide mais par une « dépression hostile » spécifique de l’adolescent qui deviendra agressif vis-à-vis des autres, incapable qu’il est de dire autrement qu’il va mal.
Donc une extrême vigilance s’impose, mais sans dramatiser à tous les coups. On estime néanmoins entre 8 et 15% la proportion des adolescents faisant une tentative de suicide, avec peut-être la moitié qui passe inaperçue.
Les facteurs de risque les plus fréquemment retrouvés semblent être :
- le chômage personnel ou familial
- l’appartenance à une famille monoparentale ou recomposée
- les difficultés scolaires
- les conduites addictives, sur lesquelles nous reviendrons.
Il faut ensuite distinguer les tentatives de suicide qui n’aboutissent pas à la mort et les suicides réussis. Les tentatives ne doivent pas être négligées, car les récidives sont plus fréquentes que ce que l’on croit, et elles traduisent une vraie souffrance ; l’abord psychologique qui en est encore trop souvent fait dans les services qui les accueillent est source de séquelles durables.
Les moyens du suicide sont différents entre les deux sexes : la violence des moyens utilisés par les garçons (accidents de circulation provoqués, armes à feu etc...) expliquent en partie le « meilleur taux de réussite » chez eux, et ce n’est pas uniquement sur ce critère qu’il faut distinguer ce qui est tentative de ce qui est désir profond de mourir.
3-Les Addictions :
L’addiction est la dépendance pathologique. Ce terme vient en fait du latin addictus, « esclave pour dette », transformé au Moyen Age en « contrainte par corps pour les non-solvables », et nous est revenu avec son sens psycho-pathologique via les psychologues anglo-saxons.
C’est donc bien étymologiquement l’aliénation de la liberté d’être et de vivre, et cela permet de placer dans le même cadre pathologique les différentes formes de dépendance. Il peut donc y avoir des addictions sans drogues, telles que le jeu, l’achat pathologique, et l’on étend la notion au « spectre addictif » : addiction au travail (que nous retrouverons dans l’anorexie) addiction au jogging, etc....
L’adolescent est particulièrement exposé au risque addictif, puisqu’il rejoint sa vision du « tout ou rien » ou du « tout tout de suite ». Pour lui, le risque majeur est l’application de ce trait comportemental à la drogue, à l’alcool ou au tabac. Il adopte facilement ce comportement, parce qu’il est susceptible de permettre à la fois la production d’un plaisir et le soulagement d’un malaise, s’organisant de manière à inclure la notion de perte de contrôle malgré la connaissance des conséquences négatives du comportement. De plus, un tel comportement est valorisé à ses yeux et à ceux de certains de ses camarades par la fierté de la transgression.
On voit bien dès lors la difficulté de lutter contre les toxicomanies, si l’on se contente de faire du tapage autour des risque encourus, puisque d’une part ces risques sont souvent intégrés, et d’autre part ils sont le plus souvent recherchés, inconsciemment ou pas (ce qui ne dispense pas de rappeler les dangers).
Les conduite addictives sont peut-être le plus grand risque pour l’adolescent : elles peuvent structurer profondément le futur psychisme adulte, ce sont peut-être les plus difficiles à dépister et celles qui amènent peut-être le plus difficilement l’adolescent à consulter : d’un certain côté, elles le protègent pour un temps d’un monde réel qu’il redoute.
4-Les anorexies :
C’est la restriction volontaire de nourriture associée à :
– une perte de poids de plus de 15% par rapport au poids antérieur ou au poids corrélé à la taille (P/T²)
– une aménorrhée
– des troubles trophiques : peau sèche, cheveux fins et cassants
– un aspect plus vieux que l’âge réel.
Elles traduisent un repli narcissique avec soi comme seul sujet.
10 filles sont touchées pour un garçon, avec un pic de survenue à 12-13 ans et un deuxième à 18-20 ans.
L’apparente augmentation du nombre de cas (puisque des pédiatres japonais ont même parlé d’épidémie) semble en fait liée à son isolement nosologique des dépressions et des autres pathologies.
Les anorexies rejoignent par certains points les comportements addictifs.
Les premiers signes d’alerte sont souvent le surinvestissement scolaire (ce qui explique les résultats supérieurs à la moyenne chez les anorexiques, alors que l’intelligence mesurée au QI est le plus souvent normale sans plus), associé à un vécu douloureux : du doute, de l’impuissance et du vide.
Le danger mortel vient de la recherche acharnée de la minceur, de la peur panique de grossir, liée à la terreur de la perte de contrôle sur un corps vécu comme dangereux. Le décès par cachexie et troubles métaboliques n’est pas une éventualité rare, et si l’on rajoute les suicides qui sont plus fréquents que la moyenne dans ce groupe, on voit l’importance d’une prise en charge rapide.
La boulimie entretient des relations complexes avec l’anorexie : on peut dire que ce sont les deux faces opposées d’une même problématique, ayant amené à distinguer les anorexiques restrictifs enfermés dans leur résolution anorexique et les anorexiques boulimiques incapables de soutenir l’idéalisation du renoncement. Ces derniers associent fréquemment boulimie d’achats, boulimie sexuelle ou kleptomanie.
Devant l’ensemble de ces troubles potentiels de l’adolescence, que pouvons nous faire, sachant que plus le dépistage sera précoce, plus les chances d’éviter des séquelles à l’âge adulte seront grandes ?
La rencontre médicale semble très importante, car elle seule permet d’établir une relation thérapeutique utile ; mais il est primordial de respecter le caractère intime et confidentiel de l’examen, c’est-à-dire le tête à tête.
L’examen somatique revêt une importance particulière, car c’est l’occasion pour l’adolescent de poser des questions sur le fonctionnement de son corps ; il faut bien prendre en compte le coté somatique, et en profiter par exemple pour traiter un acné, une pilosité excessive ou une surcharge pondérale, très souvent mal vécus par l’adolescent sans qu’il ose toujours aborder le problème frontalement.
Mais les pièges sont nombreux : fausses urgences, déni ou banalisation, investissement émotionnel du soignant qui ne sait que faire devant une biographie-catastrophe, ou au contraire, troubles émotionnels du soigné qui ne veut plus parler ou présente des signes fonctionnels qui embrouillent tout.
Nous devons nous appliquer à rester « neutres » devant l’adolescent en évitant de nous identifier à lui, y compris par le prisme déformant de notre propre progéniture. Il nous faut autant contrôler les phénomènes de rejet que le copinage passif ou actif, favorisé par des phénomènes de séduction ou de manipulation .
Le g&
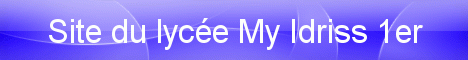
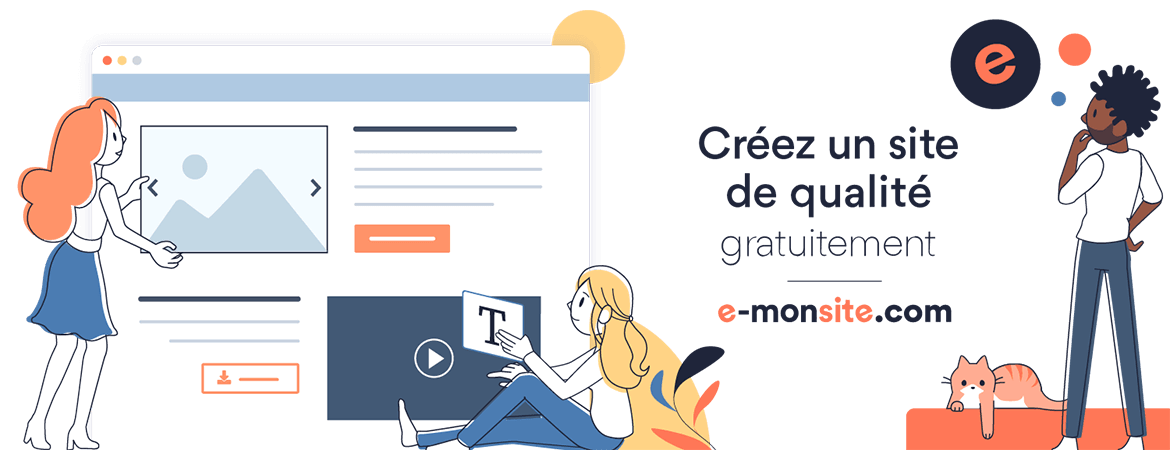

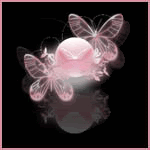




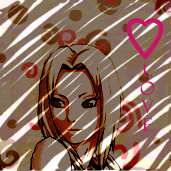



1. Par Mehdi El le 2025-04-10
Bon travail Merci
2. Par wassim le 2024-02-26
tres bien
3. Par fistone le 2023-07-09
Bon courage
4. Par mouna el achgar le 2023-07-09
je suis une enseignante de la langue française et cette année je vais enseigner pour la première fois ...
5. Par Salwa le 2023-03-18
Merci
6. Par Rbandez le 2022-11-19
Trés Bon resumé
7. Par Rbandez le 2022-11-19
Trés Bon resumé
8. Par El otmani le 2022-11-01
Bonjour Merci pour votre exemple je le trouve vraiment intéressant Auriez-vous un exemple pour une ...